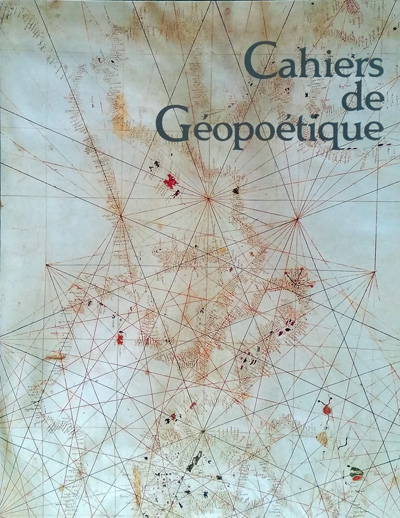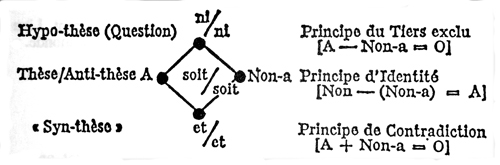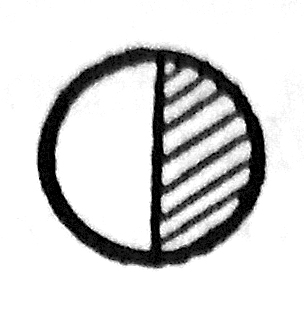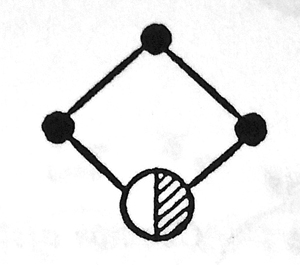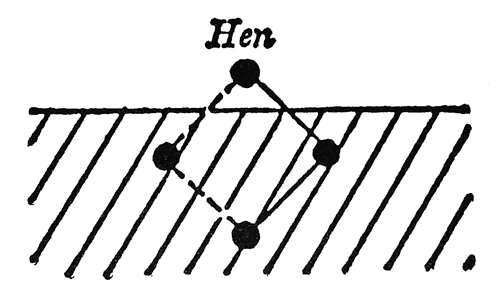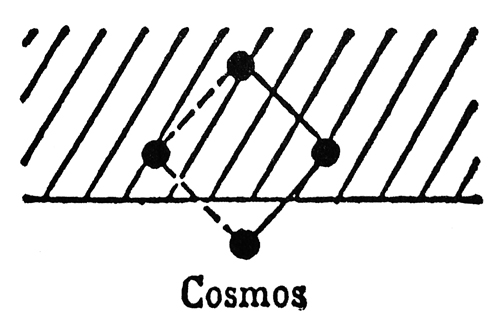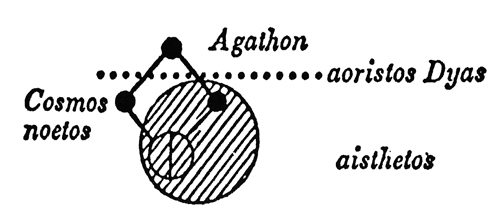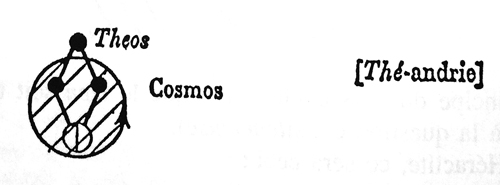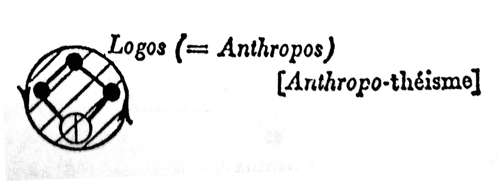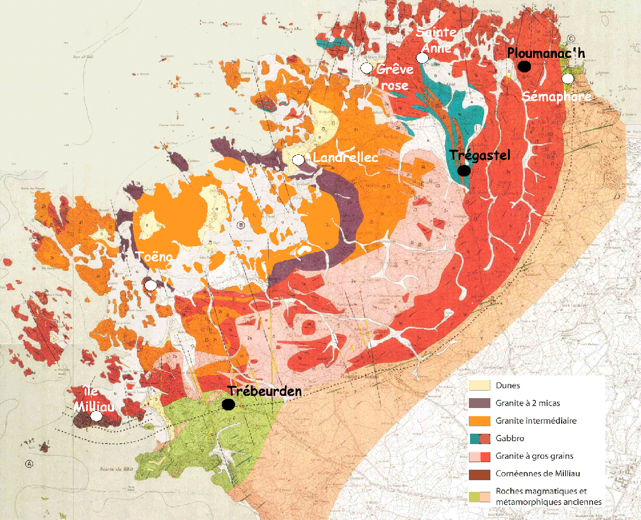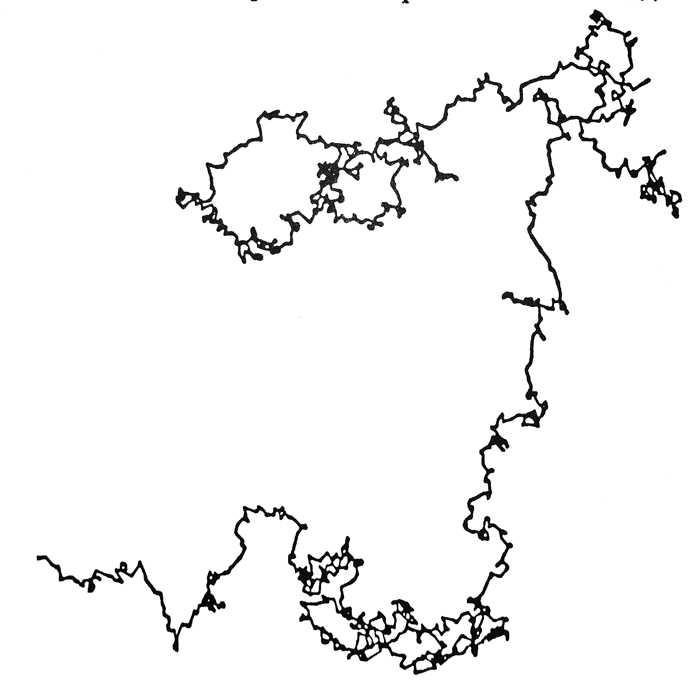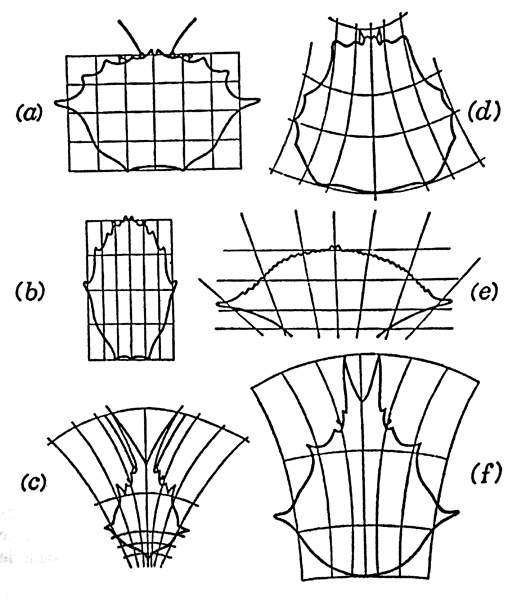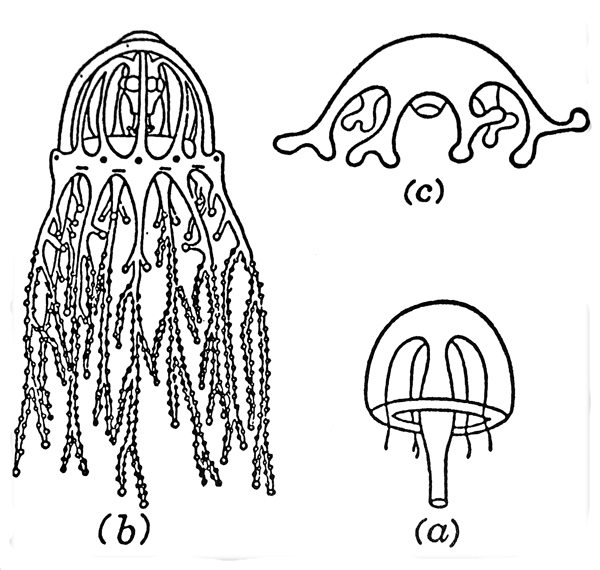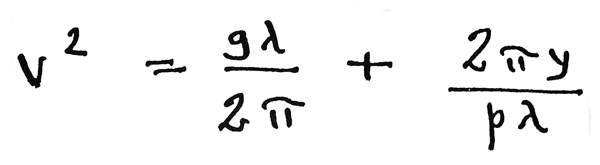Voyage sous la charte de la découverte
j’ai rencontré un jour un esquimau
aux dents usées par le sourire
qui disait s’appeler cristoriapik colombouk
c’est un pasteur morave d’origine catholique
ou un viking catholique d’origine morse
qui l’avait baptisé ainsi
peu après qu’il eut abandonné
son iceberg-caravelle et son oumiak-sixtine
aux quatre vents de la banquise
j’ai rencontré un jour un esquimau
au sourire usé par le rhum overproof
qui disait s’appeler amérigok vespousik
c’est un nom bien étrange
qu’il tenait de érik éleiffson groënlande
qui avait depuis longtemps
prévu l’arrivée de la découverte
par l’odeur de la mousse rouge
sur la chevelure des glaces
j’ai rencontré un jour le grand découvreur
des terres sans peur ni reproches
qui s’était mis prestement à crier
«terre! terre! me voilà!
attends-moi encore un peu»
mais voilà que la terre-glace se mit à bouger
et le découvreur à fondre en larmes
«comment découvrir une amérique
qui se met aussitôt à donner de la bande
et à fuir le nouveau-monde à pleines voiles
en riant par la cale jusqu’à la mer des sargasses?»
*
Eepilk
Cher Eepilk,
Dear e-five-nine-o-two
Cher E5. 902
Ta tête revient me danser dans la mémoire ballottante au moment d’entamer ce texte.
Tu as évidemment oublié depuis longtemps la lettre que tu m’avais écrite en syllabique et que je ne sais plus quel missionnaire-fonctionnaire m’avait traduite. En partie seulement, car il avait laissé en blanc un long passage, le dernier paragraphe en fait, dont on vient tout récemment de me faire connaître la teneur.
Tiens, je te renvoie tes propres mots, au cas où tu les aurais oubliés.
«Il y a fort longtemps
ma mère m’a chanté une histoire
qu’elle tenait de la mère de sa mère
qui elle-même la tenait de sa grand-mère
laquelle l’avait apprise et puisée directement dans la géographie je crois
ma mère me l’a chan… contée à nouveau
une deuxième fois puis une troisième fois avant de mourir
me faisant promettre de ne jamais en parler à qui que ce soit
so i wont tell it
je refuse de te la transmettre
je refuse de te la transmettre
il y a des secrets qu’il nous faut conserver
autrement nous n’existerons plus
nous ne serons plus rien qu’une histoire
s’envolant dans sa transmission
plus rien qu’une onde qui se referme
sous les bourrelets de la mer aux glaces
quand le phoque s’est retiré
de son trou à respirer
mais à qui donc s’adressera
le dernier animal à parler sa langue
le dernier chamane à détenir le secret
où se cachent les émotions de l’hiver après
le départ des battures
oh! je t’en prie
«janziouk oumigma»
tords-moi un peu le bras
fais-moi rouler sur la toundra
ou tire-moi la mâchoire n’importe quoi
trouve-moi vite une excuse
pour que je puisse rompre avec la tradition
et te raconter…»
*
Dear E5.902
Cher Eepilk
Je n’ai jamais cherché à inventer une excuse et voilà que je te recontacte quelque vingt-cinq ans plus tard.
Tu as disparu prématurément au cours d’un voyage de chasse, ai-je appris à travers les coulisses du keeouatin — et moi, dans la rédaction d’un Ph.D. Je ne t’ai jamais revu, mais me suis laissé dire que c’était bien toi ce vieil angagouk barbu qui continue de hanter les hauteurs de Nettilling Fjord depuis Cumberland Sound jusqu’à l’Amadjouak. C’était bien toi l’auteur de l’histoire que voilà:
«j ’étais parti un jour vers le pays des arbres et des caches
j’avais fait le vœu de faire naître une femme
une femme qui viendrait à ma rencontre afin que nous partions ensemble à la découverte de tous les autres vœux…, de toutes les autres terres et des rivières qui les entourent
mais il arriva ce qui arrive
elle était déjà mariée et trop vieille quand elle apparut
mariée avec un lac
un lac en bois rond
si on se dissimulait derrière les cailloux ou si on demandait abri à la fardoche rabougrie en été ou les sapinages en hiver on pouvait la voir nager dans son mari ou marcher en raquettes sur sa neige
mais il arriva ce qui arrive
le printemps hâtif fondit la neige jusqu’aux racines cette année-là et la pluie ne revint pas avec grand fracas et empressement
même les outardes passèrent plus vite que d’habitude
le lac disparut peu à peu et le soleil assécha ce qui restait de son mariage
lasse de dormir la nuit durant auprès du trou ambré qui avait été autrefois son mari la vieille femme me demanda de formuler un autre vœu
après bien des efforts je réussis à faire venir un orage mais comme j’avais oublié les éclairs et les piquets pour faire tenir le site en place la pluie n’arriva pas à réinstaller et à contenir le lac en bois rond et il fut bientôt sec à nouveau
c’est alors qu’il arriva toujours ce qui arrive
taléyou car c’était là son nom partit à la recherche de son mari en suivant jusqu’à l’hiver les dernières flaques d’eau c’est-à-dire les empreintes des pieds de l’orage
mais les flaques se changèrent bientôt en petits bancs de neige qui couraient sans cesse d’un endroit à l’autre difficile alors de mettre la main sur son homme
mais à la fin elle reconnut une odeur familière et finit par trouver son mari car il s’était trompé de trou
il arriva donc toujours ce qui arrive
taléyou essaya avec ses mains de ramener peu à peu son homme dans son lac mais elle échappa cependant tout au long du chemin plein de gouttes de mari et plein d’essence d’esprit
il n’y en eut bientôt à peu près plus pour son lac et l’hiver fit disparaître dans son estomac le long de la trail ce qui restait de mari
et il arriva à nouveau ce qui arrive
la femme redevenue jeune me demanda de faire un vœu afin de partir à notre rencontre mais j’ai oublié alors quelque chose — quelque chose comme une bilboquet en os de baleine — et voilà que ma femme-vision disparut aussitôt comme lièvre dans la brume
si vous étiez restés là derrière les fourrés de neige au lieu de m’écouter vous auriez peut-être pu m’aider mais je me retrouvai tout fin seul
la suite de l’histoire disparut alors avec le vœu si bien qu’on n’en connaîtra jamais la fin…»
*
Eepilk, dear Eepilk, tu ne changeras donc jamais. Tu racontes tout, sauf la fin. C’est peut-être la raison pour laquelle je n’ai oublié aucune de tes histoires, j’attends toujours ce qui adviendra après, de l’autre côté de l’histoire.
Bah! Ce n’est guère plus révélateur, de mon côté. Comme tant d’autres «field workers» à l’emploi de l’Empire, j’ai disparu, à mon tour, dans les limbes de la raison et tu n’as jamais entendu parler de moi. Mais, jamais je n’ai oublié.
Jamais je n’ai oublié ton sourire, le grand sourire de l’Amadjouak, colonne de glace écumante se promenant sur les franges de la banquise, tête haute, parole en cascade.
Je me souviens quand on s’était rencontré pour la première fois. Sur un «primus» de fortune importé de Suède par la Groënlande, tu nous avais servi un thé en pleine mer. Un thé bouillant préparé dans ton embarcation agitée par les vagues et le passage d’un troupeau de narvals au large du pack à demi-disloqué. Au beau milieu du rentrant de l’Amirauté du Haut-Arctique, entre la Terre de Baffin et l’Isle sans Fin.
Tu réparais ton poêle à naphta avec des pièces de ton hors-bord et vice versa. Quand ton moteur volait en éclats sous la pression du désir, de la faim ou de la chasse, tu refixais le tout avec un grand éclat de rire et des pièces de ton poêle portatif. C’est ce qu’on appellera, sous d’autres cieux, le recyclage du mouvement perpétuel.
Il faudrait peut-être, Eepilk, consulter les spécialistes en la matière pour connaître le processus de fabrication et le mode d’emploi. Parenthèse. Ouvrez les guillemets.
«Les Esquimaux, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, écrit l’anthropologue, sont les plus habiles artisans de la planète.»
C’est ce qu’on n’avait cessé de répéter aux ingénieurs yanquis de la Dew Line qui, après s’être longtemps demandé quels ouvriers allemands ou japonais ils allaient importer pour construire la ligne radarisée du Haut-Arctique, avaient soudainement découvert que le territoire était peuplé d’Inouites. Et toi, Eepilk, tu avais été l’un des premiers à être embauché. Tu avais travaillé à Cape Dyer, Igloolik, Frobisher Bay, etc., sans avoir jamais voulu consentir à jouer le plus habile esquimau de je ne sais quel projet. Tu voulais aller à la chasse et, chaque été, tu quittais ton travail pour reprendre ton harpon.
Tu voulais être heureux et mobile en même temps; l’un n’allait pas sans l’autre. Ne jamais arrêter, ne jamais t’arrêter, sauf… pour repartir! Tous les fonctionnaires qui allaient assassiner, dans les années qui allaient suivre, l’esprit esquimau, le savaient très bien. Ils allaient vider de force tous les camps d’été et installer les gens dans des établissements fixes — des permanent settlements — afin que toute l’Amérique devienne un jour aussi rectangulaire que le Nord-Dakota avec, au centre, la «main street» croisant la 51e avenue. Ou, l’avenue John Fitzgerald Kennedy rencontrant le poste de Little Chicago, par 75° de latitude nord.
Merde, Eepilk! Et moi, fils de Canadiens errants de Belle-Chasse, né des entrailles mêmes du «chemin qui marche» dans un iglou à deux étages entre les marées enneigées et le nordêt, j’étais là convié à participer à cette mise en réserve sans même le savoir.
LUOS! Land Use & Occupancy Study, Étude d’utilisation et d’occupation des terres, c’était là notre mandat. Combien de phoques? Combien de cariboux? Combien de bélougas, Eepilk? Que fais-tu dans la vie, Eepilk? E-five-nine-o-two. Combien de femmes? Combien de huskies, combien de chiens, combien de rêves? Oh! pardon, je te prie de m’excuser, ce n’est pas écrit dans le formulaire.
Et combien de mers, combien d’icebergs as-tu attrapés? Décidément, ce n’était pas écrit non plus. Mais lorsque j’étais là-bas, le vieil Arkeeagok, à la question a répondu: douze huskies blancs. Blancs. Et il a ensuite voulu savoir ce que le gouvernement avait écrit sur cette grande feuille couverte de signes étranges.
«Euh, c’est que…
— Mais, comment, le gouvernement veut seulement connaître la quantité de chiens sans vouloir rien savoir de leur couleur? Je suis le seul de tous les postes à posséder douze chiens plus blancs que neige, parce que je les ai mélangés avec du loup, au plus froid de l’hiver. Si mes huskies sont plus blancs que la banquise, si mes harnais de babiche, mes gréements d’ivoire blanc et mon kométique d’os de baleine blancs sont plus blancs que l’ours le plus blanc, c’est moi qui tuerai le premier phoque et fuck gouvernement!»
— Alors, Arkeeagok, quel est ton nom? Je veux dire, tu dois bien avoir un surnom quelque part.
— L’homme-aux-douze-huskies-blancs
— Ça va, j’ai compris. Je vais l’écrire.»
*
Dear Eepilk,
Cher E5 etc.
Des visions et des images qui me reviennent. Contrairement aux autres Esquimaux, ce n’était pas à du chain-smoking que tu t’adonnais, mais au thé à la chaîne — chain-teain. Courtois et moqueur, tu offrais toujours un thé aux ours polaires que tu croisais sur le floe et tu levais toujours ta tasse à la santé des cariboux, en guise d’imitation de quelque baleinier qui avait fini ses jours dans la soute d’un orqual. «Orange-peacock-nanouk-tea , avec ou sans sucre, take it or leave it.»
Rien ne t’amusait plus que ces kadlounas qui, incapables de distinguer la glace d’eau salée de la glace d’eau douce, préparaient la concoction impériale en faisant fondre de la neige salée dans la théière du camp. Yeurk! Imbuvable. Et tu poussais un éclat de rire à faire reculer d’un autre cran la glaciation.
Histoires, Eepilk. Tu ne t’arrêtais jamais.
Tu ne t’arrêtais jamais de raconter une histoire, sauf pour en inventer une autre. Comme pour tous ceux de ton espèce — la tribu des «pas-pareils» —, on allait dire plus tard de toi que ta parole était celle du poète. Dès qu’il ouvrait la bouche, un poème en sortait pour aller aussitôt se poser sur le premier iceberg.
«Mais, comment dit-on «poète» en esquimau?», t’avait demandé un jour un explorateur bien intentionné. En esquimau, avais-tu fini par répondre, le mot poète se traduit par … euh! par le mot «esquimau». Inouk, l’homme vrai, l’homme qui chante.
Et alors, qu’est-ce que tu es devenu, exactement? Un chamane? Un angagok? Non, je suis demeuré un chasseur. Un chasseur qui harponne plein d’histoires chaque fois qu’il part en kayak. Existe-t-il chose plus merveilleuse qu’une tempête?
Une tempête de neige grésillante dont on attend la fin sous la tente-iglou portative, quand la mer est trop houleuse pour continuer le voyage et qu’il y a encore plein de nourriture en réserve. Alors, au lieu de s’évertuer à tuer le temps, on lui caresse le ventre pour mieux le faire éclater de plaisir.
Ce sourire qui attrapait toujours ton visage et illuminait ton anorak, Eepilk, quelques minutes avant le début de l’histoire. On pressentait que quelque chose allait venir. Des mots magiques, puis… un long silence turgescent. Et, tout à coup, voilà qu’une parenthèse s’ouvrait d’elle-même dans le clin-d’œil d’une éclaircie.
«J’étais parti dans mon kayak
j’avironnais doucement
au fond du fjord netsilik
j’étais pas tellement loin
parmi les derniers blocs de glace
le pétrel qui souriait sur l’eau
tournant la tête par-ci
pointant le bec par là
ne m’avait pas encore aperçu
soudain rien qu’une queue
qui godillait dans l’air
c’était pas à cause de moi
qu’il avait plongé d’un coup
il faisait si calme
qu’on entendait clapoter les mirages
le soleil bleu sur la poitrine du printemps
non c’était pas vraiment pour moi
une immense tête fusa hors de l’eau
gros phoque barbu aux grands yeux curieux
qui te regardent comme un être étrange
le phoque est dans sa peau
comme l’esquimau dans son kayak
sauf qu’il y reste pour la vie lui
alors que l’esquimau peut quitter
sa deuxième enveloppe à volonté
dis-moi gros phoque barbu
moustache bien peignée
lippe dégoulinante
si tu crois que c’est avec cet appareil
que tu vas séduire nouliadjouke
la mermaide des profondeurs
tu t’es trompé de pelisse…
gros phoque un peu baba
tu t’avances vers moi comme si j’allais t’aimer
et le sillage des loutres marines
qui veulent voir ce qui se passe
tu crois que je n’aime pas autant que toi
tu t’avances vers moi si gentiment
je n’ai pas faim du tout tu sais
mais j’ai aussi encore faim si je veux
vieil oukdjouk au cou plissé de volupté
qui te cherches une vieille oukdjouque
allez allez ne me raconte pas d’histoires…
mais pourquoi donc dis-moi
trop belle journée de printemps
pourquoi donc mon bras a-t-il refusé
de harponner oukdjouk le bienheureux
c’était si facile
pourquoi mon bras n’a-t-il rien fait
pitié ou distraction
ou parce qu’il était aussi curieux que moi
cette journée-là
et qu’il faisait trop beau
pour faire autre chose que
de se laisser dériver sous le soleil…»
*
Je laisse les guillemets repartir, à leur tour, entre les glaces.
Allons, Eepilk, tu te laisses attendrir. C’était quoi au juste ton histoire? Tu n’avais vraiment pas faim? Je ne sais pas du tout si je dois croire ta parole. Si tu te sentais trop bien pour tuer Oukdjouk, c’est que seul Oukdjouk connaît la vérité, alors. Mais, qui veut connaître la vérité, au juste? Il faut se laisser être heureux après tout, surtout avec la tempête qui reprend de plus belle. Disparu le calme qui jouait à faire des ronds sous les soleil avec les glaçons, il y a quelques regards à peine.
Une autre tempête, une autre période d’attente! Un autre moment pour être bien et non pas tant réfléchir que de se laisser réfléchir. Une bonne tempête pour se laisser transporter par le plaisir, par un ancien plaisir plus vieux encore que les premières histoires qui réapparaissent alors.
«C’était aux temps où les mots étaient des êtres vivants
aux temps des tout premiers commencements
et même un peu avant
aux temps où l’animal et l’homme
vivaient ensemble sur la terre
tout être pouvait se transformer en animal
s’il en faisait le vœu
tout animal pouvait devenir humain
s’il en exprimait le désir
quelques fois on était homme
d’autres fois on était animal
tous parlaient leur propre langue
tous entendaient la même langue
c’était aux temps où les mots étaient des êtres vivants
allant et venant à leur guise jusqu’au pays des glaces parlantes
l’esprit de l’homme était nymphé de mystérieux pouvoirs
un mot prononcé au hasard pouvait s’envoler à tire-d’ailes
et se poser sur la tête d’un autre chasseur en criant son nom
tout ce que tu cherchais à voir pouvait apparaître
il ne te suffisait qu’à prononcer le mot
qui partait aussitôt à la recherche de ton son
quelquefois c’était le mot lui-même
qui arrivait le premier pour te prononcer
pourquoi il en était ainsi
aucun esquimau n’aurait su l’expliquer
parce qu’aucun esquimau n’aurait pu se douter
qu’il aurait pu en être autrement»
C’était l’époque en effet où l’esquimau était un animal en marche qui pouvait suivre à pied, derrière ses chiens, une craque, une ouverture sur la banquise durant des dizaines et des dizaines de milles jusqu’à ce que l’espace s’amenuise pour qu’on puisse la traverser.
Et lorsque le chasseur s’arrêtait pour traquer un phoque, les mots continuaient à déambuler. Mots nouveaux, mots angulaires, de toutes formes et de toutes grandeurs; mots dansant comme des blocs glaciels sur l’écume de la débâcle; mots changeant de fourrure avec les saisons. Quelle fête! Quelle joie pour tous que de surveiller, chaque printemps, le retour des anciens mots nouveaux. Outarde, pétrel, pluvier, kildir, les grandes oies musquées, quelquefois même un mot de plus grande envergure déployait ses ailes, faisant deux ou trois fois le tour du campement avant d’aller se poser sur un caillou solitaire, histoire de se laisser apprivoiser et de donner son nom à quelque esquimau qui allait lui ressembler.
C’était l’époque où Oukpik, le grand hibou des blanches neiges, qui avait poussé directement sur un nounatak te regardait avec des yeux de moraine. Tu ne savais jamais sur quoi il méditait. Hibou-soleil, pouvoir de tous les silences. C’était l’époque, dis-je, où l’esquimau était un animal en marche. L’époque où l’homme marchait, marchait, marchait, et marchait encore à la poursuite d’un caribou.
La marche!… Comme l’appétit de l’être entre la faim et l’éternelle errance. Car quiconque n’a jamais vu un caribou déambuler sur le dos d’un esker…, quiconque n’a jamais vu un caribou qui n’avait jamais vu auparavant l’être à deux pattes qui le regarde…, celui-là ne court aucun risque de subir un coup de foudre inter-espèce.
«Caribou, caribou, je t’aime, disait Eepilk en salivant des dents.»
caribou caribou
touktou
piouyouk
mousse de caribou
pousse de caribou
toundra mobile
esker qui roule
caribou caribou
piouyouk
touktou
toujours en mouvance
sur la pointe de l’horizon
avec tes longues pattes
tes oreilles écoute-tout
caribou caribou
touktou
piouyouk
amène tes empreintes par
le raccourci de la muskègue
viens manger la cladonie
dans la paume de la vallée
caribou caribou
piouyouk
touktou
viens je t’implore
laisse-toi avancer
je suis là qui t’attend
caribou caribou
touktou
laisse-toi attraper
aide-moi à te manger
sans que j’ai à te tuer
C’était l’époque où la terre elle-même était un animal en marche changeant de nom avec les saisons. Tu te souviens de «Pallik», Eepilk? Nous avions rampé durant des minutes qui paraissaient des heures sur la mince pellicule de glace, tentant de léviter notre propre corps pour ne pas faire sombrer notre support qui se stridulait sous nos pieds. Un immense pan d’eau ouverte, là-bas, nous narguait par petites vagues. Mais, qu’est-ce donc que la mort, Eepilk? J’avais l’impression que tu en savais déjà quelque chose. Un goéland rouge passa, nous lançant son cri par à-coups quand soudain, la glace se mit à crier à son tour. Un grand frisson parcourut l’échine de la banquise. «Attention ! Attention! Nous allons caler.» Puis la glace se mit à crier encore plus fort. Une hystérie de craquements. Nous étions dépassés par la débâcle, les gouttes de pluie se changèrent en glaçons, les glaçons en maringouins, et les maringouins en gouttes de sueur.
Quelle peur, Eepilk. Tu étais plus sérieux qu’un bœuf musqué. Quand soudain on entendit prononcer nos noms. Nous étions sauvés. Les autres arrivaient à la rescousse, nous sautâmes dans l’oumiak synthétique et, une heure plus tard, la glace était partie et nous aussi.
Tu te souviens ? L’orage du Lac Nettilling? Il y a des années où le lac ne se décharge même pas au complet. Et des glaces vieilles et infirmes, de vieux icebergs éclopés et handicapés se remettent soudain en mouvement, hurlant sourdement leur existence.
Tu te souviens de l’orage ? Il y a pourtant des années où le temps ne se réchauffe même pas assez pour laisser au tonnerre le loisir de réclamer son dû. Mais, cette fois-là, la tempête laboura le fond du lac, des vagues de trente pieds se formèrent là où il n’y avait pourtant que vingt pieds de tirant d’eau, et les bouldeurs se mirent à danser une jigue géologique avec les glaces.
C’est alors que se fit entendre un grand éclat : le rire de l’Amadjouak. Ton rire chantant, Eepilk.
Eh, hé, éh, Ya-Ih!
Eh, hé, éh, Ya-Ih!
Mais, dis-moi, Eepilk. Tu n’es pas seulement ce que tu es. Ce chant des gens de l’anus-des-bois qui te vient à la bouche, ce n’était certes pas une mélopée esquimaude. Mais où avais-tu appris, au juste? Qui étais-tu donc? Un angagok?
*
C’est à mon tour maintenant de te parler et de te raconter «mes» histoires. Je vais t’appeler par tes nom et prénom. Le prénom honorable que tu as reçu en héritage des fils de l’Empire britannique et successeurs, Ltée. Nous sommes nés tous deux «british subjects», citoyens off-shore ou sujets hors-réserve. Je sais de quoi je parle.
E 5, 9 0 2
E-five-nine-o-two. Je dois le dire en anglais, bien sûr, les mathématiques, en inouttitout, se calculent en shakespeare. Et les mots magiques de la toundra ont vite fait de changer de sens dans la gueule des Polices Montées. Quand j’ai appris, pour la première fois, que chaque Esquimau avait reçu un numéro — E5-907, E9-709, etc. — E pour esquimau ou pour «Eastern Arctic»: le numéro, pour identifier la région d’origine dans je ne sais quelle taxonomie des administrations zoologiques, et le reste, comme nom de baptême octroyé par la Police Montée sans cheval du Grand Nord; quand j’ai appris cela, j’en ai frémi jusqu’aux ouïes, Eepilk. Moi qui suis de Belle-Chasse en Canada, et qui n’ai pas encore de numéro. Et la Police Montée, quel est son stigma? «Dieu est mon roi» ou «Honni soit qui mal y danse»?
Et tes gènes alors, quel numéro portent-ils dans les dossiers de l’Empire? Les techniciens sont en train, paraît-il, de mettre au point une banque génétique, pour recueillir un échantillon et conserver le sens de chaque dernier «last-indian». Es-tu à toi seul, une espèce en voie d’extinction, Eepilk? Si oui, tu as droit à déposer quelques gouttes de ta quintessence en éprouvette, avant ton départ. Et si tu survis un jour à ton destin, à l’entrée du XXIe siècle, tu auras droit alors à retrouver ta substance dans l’utérus de la sociologie galopante. Tu renaîtras un jour par transfusion anthropologique.
Au fond, je me demande si ta mère n’avait pas raison de vouloir maintenir la tradition du grand secret. [Et la mienne aussi d’ailleurs. Je te raconterai un jour tout ce qu’elle ne m’a jamais révélé.]
Et surtout, nous disait-on, à nous tous Kadlounas ou Ouiouimiut qui montions pour la première fois dans le Grand Nord… «Surtout, n’oubliez jamais que le seul voyage bien réussi est celui dont on revient vivant.» [Les nôtres, en toute confidence, s’avéraient à moitié réussis.] Telle était donc la notice laconique qu’on glissait dans tous les documents préparatoires à nos expéditions entre une photographie aérienne de la US Air Force et la carte topographique préliminaire d’une région préliminaire dont le relèvement isostasique n’avait pas encore été approuvé par la reine.
Des années plus tard, j’allais tomber sur des textes cabalistiques dans lesquels les métaphysiciens de la chose esquimaude allaient se poser très sérieusement la question qui suit: «Does the Eskimo need the Arctic or does the Arctic need the Eskimo ?» En d’autres mots, l’Arctique, laissé à lui-même, c’est-à-dire à l’État, pourrait-il survivre, c’est-à-dire continuer à exister sans les Esquimaux? Et, réciproquement, l’Esquimau pourrait-il survivre sans le gouvernement? Question… subtile, dont le renard blanc le moins averti aurait fait vitement l’analyse et le procès. Mais avant qu’on ait pu d’ailleurs répondre à quoi que ce soit, voilà que «gouvernement» était arrivé comme un cancer, une tumeur géographique cervicale qui n’allait pas être délogée de sitôt.
«La première fois que j’ai vu arriver «gouvernement», allais-tu raconter lors du bivouac de la deuxième tempête, il était accompagné d’une femme en talons hauts qui marchait sur la garnotte. Jamais n’avait-on vu apparition plus insolite : elle s’appelait «cour itinérante de justice» et venait examiner les Esquimaux coupables de crimes infâmes, d’esquimologie et d’autres méfaits dont on allait connaître la teneur. Tous essayaient de mettre la main sur «gouvernement», mais impossible: il s’agissait d’un monstre insaisissable qui changeait de forme à chaque fois qu’on allait lui mettre la main au collet.
«Gouvernement» était un bien étrange personnage. Une fois, un bateau ; une autre fois, un avion; et une autre fois encore, une grosse enveloppe brunâtre, un agent de police, un «area administrateur» ou une boîte de ration — made in Canada. Pour employer l’une des toutes premières expressions vernaculaires «anglo» apprises et répétées par toi, noble Eepilk, «what a flying shit, government!»
«Où peut-on le rencontrer? avais-tu demandé au juge itinérant sur bible et serment à la reine, qui venait de te condamner à deux jours de prison pour chasse illicite (selon la clause 3-c, paragraphe b, alinéa d des Game Ordinance Regulations). Tu étais en furie. Deux jours de prison, a-t-on idée! C’était nettement insuffisant. Il aurait fallu au moins une semaine, sinon un bon trois semaines, afin de pouvoir être envoyé dans le Sud pour purger ta peine. Mais, qui au juste était le plus coupable? Toi ou l’oiseau qui s’était laissé chasser sans autorisation de la cour de justice?
Et ce n’est pas tout. À la fin des années cinquante, les lois canadiennes règlementant les activités de chasse, de pêche de même que les allées et venues des oiseaux migrateurs et ta-ta-ta, n’avaient pas encore été adaptées à l’Arctique. Si bien que la seule période de chasse autorisée coïncidait avec un temps où les oiseaux avaient déjà quitté le paysage, depuis un bon bout de temps. Il y avait un hiatus géographique quelque part. Il fallait ou changer la loi ou changer les volatiles ou changer les Esquimaux. Après réflexions approfondies et plusieurs meetings, sans parler des crises de conscience profondes chez les hauts fonctionnaires, on décida qu’il serait plus simple de changer les Esquimaux. Après lecture, bien entendu, des propos du grand anthropologue dont je tairai le nom. Ouvrez les guillemets.
«Les Esquimaux excellent en tout ce qui touche la fabrication artisanale et constituent sans doute les plus habiles de tous les aborigènes du Canada. Les explorateurs de l’Arctique ont été renversés devant tous les articles que les Esquimaux manufacturaient. Dans le domaine de la vie sociale et des croyances religieuses, les Esquimaux se classaient, cependant, en-dessous de la plupart des tribus indiennes.
Ceux qui se rapprochaient le plus de l’idée d’officier public étaient les chamanes. Ils accomplissaient quelquefois des tours de passe-passe et des jongleries semblables à ceux des sorciers-guérisseurs ou medecine-men indiens et pratiquaient la divination en soupesant une tête ou un pied, mais leur pratique usuelle consistait à déclencher en eux une espèce de démence temporaire, une hystérie arctique, comme on appelle le phénomène. Et, sous une telle condition, à laisser s’exprimer des râlements et divagations plus ou moins incohérents que le non-initié prenait pour des oracles.
La religion des Esquimaux leur apportait très très peu de réconfort. Si l’Esquimau s’était révélé, par ailleurs, un être morose ou sans verve, on serait tenté de suggérer que c’était l’extrême dureté du climat et du combat pour la vie qui rendait leur religion si ténébreuse, mais au contraire, les Esquimaux sont apparus comme le peuple le plus enjoué et le plus riant des Amériques.
La religion des Esquimaux et leur tempérament semblent varier de façon déconcertante. Outre les performances des chamanes, le mariage était une cérémonie tout à fait spéciale conclue presque sans bénédiction. Il est vrai que le gendre avait été auparavant convié à la chasse avec ses beaux-parents, le temps de faire connaissance durant une ou deux saisons. Une partie ou l’autre pouvait dissoudre l’union à volonté et les maris allaient jusqu’à échanger leur femme pour quelque temps. Les Esquimaux considéraient l’amitié bien au-dessus de la chasteté [merci Eepilk] et entretenaient, en effet, bien peu d’estime pour cette dernière. Les couples demeuraient néanmoins unis.
Avec de bonnes politiques gouvernementales, les Esquimaux devraient plus ou moins se survivre au cours du présent siècle et, sous l’amalgamation graduelle avec les trappeurs blancs, les commerçants, les hommes de troc de la Compagnie de la baie d’Hudson, etc., ils devraient produire le dur et ingénieux cheptel humain nécessaire au développement du Grand Nord canadien pour l’éternité.»
Fin de la citation.
Voilà, en résumé (page 57, 422, etc.), les principes politiques sous-jacents à la grande épopée nordique pancanadienne. Les ardentes analyses auxquelle se livrait une telle anthropologie n’arrivaient pourtant pas à dissimuler la hantise et la peur du Nord. «N’oubliez jamais que le seul voyage bien réussi est celui dont on revient vivant…»
Je me demande quelle saine recommandation on vous servait, vous les Esquimaux, lorsqu’on vous embarquait pratiquement de force pour le grand voyage initiatique dans les brise-glace. Tu as eu la tuberculose, Eepilk, trois annnées d’hospitalisation dans le Sud t’avaient donné sinon la guérison, du moins une langue de plus : le frenchglish-tîtut. Tu avais réussi, avec le temps, à te remettre tant bien que mal et de la tuberculose et de l’hôpital. Et voilà la suite de ton histoire.
Issu d’Inoucdjouac, au Nouveau-Québec, et de Pond Inlet, en Nord-Baffin, à près de 1500 milles de distance, tu avais eu deux naissances. Et je t’ai rencontré au moment où tu tentais, seul avec huit chiens, de refaire, en rêve et à rebrousse-glace, le grand périple de ta déportation. Tu avais été de ceux qui avaient participé à la grande migration forcée des années cinquante.
Craignant, en effet, d’abandonner le Haut-Arctique aux mains des Scandinaves, des États-Yanquis, sinon des Russes, quelques hauts fonctionnaires inspirés avaient décidé de se servir des Esquimaux pour occuper stratégiquement jusqu’au pôle le territoire sis au-delà du 75°, afin d’assurer la souveraineté du «Dominion» sur ces terres-mers incertaines. Et pour remplir une mission aussi valeureuse, «gouvernement» t’avait donné un vieux fusil avec comme mandat de tirer à bout portant sur tout sous-marin, soviétique ou autre, qui pourrait émerger du pack. Ainsi, les Esquimaux allaient-ils servir de zone-tampon stratégique et de trame géodésique pour asseoir la présence militaire en Haut-Arctique.
Il n’était pas question de citoyenneté canadienne pour autant. Avant donc de «dispatcher» les Esquimaux pour un aussi long périple, il fallut d’abord les canadianiser avec un certificat de citoyenneté et une bouteille de scotch sur la coque, à peu près comme pour le lancement d’un navire. Comme les Esquimaux n’étaient pas apparemment des immigrants en terre canadienne impériale — c’était plutôt le Canada qui leur avait migré sur l’occiput —, on dut faire modifier les formulaires de naturalisation. Mais, comment «naturaliser» un «naturel»? La question fera sans doute un jour l’objet d’un doctorat, mais faute de savoir, hop! on poussa prestement les Esquimaux à bord des brise-glace. Premiers boat people avant la lettre de la grande saga panaméricaine!
Mais une fois de retour au lieu mobile de ta naissance, tu n’étais plus et ne serais jamais plus le même, Eepilk. Entre le bar de Frobisher Bay et la fermentation de chasses irrémédiablement perdues, tu avais décidé de rédiger tes mémoires, à grand renfort de cannettes de bière. Le monde avait changé, les bélougas portaient cravate et attaché-case et devaient, pour survivre, «ouncher» leur neuf-à-cinq quotidien jusque sous les ombres du soleil de minuit.
Comme tant d’autres, tu allais sombrer dans l’alcoolisme et ton histoire allait rouler sous les tables, de bière en bière, jusqu’à ce qu’on te découvre gelé, un soir de lune crépusculaire, avec toujours, cet immense sourire éclairé aux coins des lèvres : le grand rire de l’Amadjouak. Et un petit papier qui disait ceci :
«toi l’étranger aux sourcils épais
qui nous vois toujours comme un animal heureux et sans souci parce que tu viens nous visiter au cœur de l’été
au moment où tous ceux qui ont survécu font bombance
et rient au soleil de se savoir toujours dans la vie
toi l’étranger à l’esprit fébrile
qui cherches ce quelque chose avec plein de nourriture dans tes besaces
sois le bienvenu parmi nous et que personne ne te demande ce que tu viens faire ici
tu as droit à tes égarements et étonnements
et si tu restes assez longtemps
tu comprendras l’amour insensé que nous ressentons pour le manger le chanter le tambour et la danse
si tu restes assez longtemps
tu comprendras pourquoi nous frémissons devant les sentiers millénaires qui amènent le caribou
et devant le trou de glace qui fait venir le phoque respirer
toi l’étranger aux cheveux de ptarmigan ou à la tignasse d’oumigma
jamais tu ne rencontreras un seul inouk qui n’ait pas passé dans sa vie un hiver ou deux de mauvaise chasse
jamais tu ne rencontreras pourtant un seul inouk qui t’avouera se demander pourquoi
pourquoi lui a survécu alors que plusieurs allaient mourir
toi l’étranger aux yeux bleus
toi l’étranger aux yeux doubles avec tes lunettes d’approche écoute ce que je te dis
j’ai vu une fois un vieil homme affamé se faire passer lui-même de vie à trépas avec des os de phoque plein la bouche afin d’avoir plein de venaison au pays des morts
j’ai vu une fois une vieille femme affamée appâter un hameçon avec la chair flasque et desséchée de son propre bras afin d’attraper le poisson qui allait lui sauver la vie
j’ai vu une autre fois durant l’hiver de la grande famine de l’autre côté d’igloursouïte une femme donner existence à un enfant alors qu’autour d’elle tous reposaient silencieux et atterrés mourant de faim
qu’est-ce que ce bébé pourrait bien tirer de la vie
comment pourrait-il continuer alors que sa mère tombait de starvation sous la sécheresse de l’agonie
c’est alors qu’elle étrangla sa géniture laissant congeler le sang de son sang pour l’avaler quelques jours plus tard afin de rester du côté des vivants
la poudrerie se mit à diminuer soudain sur la banquise à travers le trou à respirer on vit apparaître netsik le phoque et bientôt il n’y eut plus de famine
la mère survécut mais aussitôt elle se paralysa sur place parce qu’elle avait dévoré cette partie d’elle-même qui cherchait à se retransformer en placenta pour la dévorer de l’intérieur à mesure qu’elle s’alimentait
elle mourut peu de temps après incapable de se nourrir davantage et je me refuse de la juger
nous les Esquimaux avons tous passé par le délire de la faim
comment quelqu’un qui mange jusqu’aux oreilles peut-il comprendre la folie qui nous fait vivre chanter et rire
tout ce que nous savons c’est que nous voulons tellement vivre que nous en mourons quelquefois»
Je refuse de juger à mon tour, mais qu’il me soit permis de témoigner. Qu’il me soit permis de t’offrir un dernier texte posthume, Eepilk.
«Il est un fleuve inconnu
que tous ont voulu découvrir sans jamais y arriver
et qui les nargue allègrement du haut de sa source
depuis la dunette des écritures et la grande coulée du désir
chaque fleuve découvert est un fleuve qui change ses eaux
il est un fleuve secret
qui prend sa source dans les affluents de l’invisible
et se nourrit de tous les codex et tous les pemmicans
pour se jeter ensuite aux quatre coins du firmament
chaque fleuve caché est un fleuve qui conserve ses couleurs
il est un colomb-cortez cabral-cartier égaré
pourvu de traîneaux espagnols kométiques portuguais
cottes de mailles parfumées à la française
saganaches à longs sourcils préhensiles
et qui remonte chaque jour vers sa confluence
chaque explorateur qui se perd est un fleuve qui se retrouve
il est un fleuve en liberté
qui les regarde passer depuis les tout débuts
sous le ballet-jazz des aurores boréales
et dont ils n’ont jamais perçu la moindre agitation
chaque fleuve sidéral est un fleuve qui sourit
il est un fleuve nommé chinouk
qui jaillit de l’alaska jusqu’à la terre de feu
et danse de la patagonie à la terre d’ellesmere
sautant d’isle en isle jusqu’à l’atlantide
chaque fleuve qui s’envole est un fleuve qui chante
il est un fleuve nommé amérique
il est un fleuve nommé eepilk
qui prend sa source dans son embouchure
pour disparaître en amont de toute découverte»
Adieu, Eepilk et…
longue vie à tous les angagoks.
*
NOTES
Certains des contes et des poèmes qui émaillent cette narration sont des transpositions de textes déjà publiés. J’en donne la référence ci-dessous bien que j’aie librement modifié, sinon entièrement transformé, l’esprit et la lettre de la plupart d’entre eux. Pour ma part, je suis passé par Baffin en 1963, 1964 et, à nouveau, en 1967.
J’avais fait le vœu de faire naître une femme.
Adapté d’une histoire cree racontée par Nibénégé-Sabee et rapportée par Howard Norman.
C’était aux temps où les mots étaient des êtres vivants.
Texte entièrement transformé, inspiré d’un chant esquimau de Naloungikak intitulé «Mots magiques». Recueilli par Knud Rasmussen, adapté par Edward Field et rapporté par Jerome Rothenberg dans Shaking the Pumpkin, New York, Doubleday, 1972, p. 45.
Caribou, caribou.
D’après un chant esquimau intitulé «Mots magiques pour chasser le caribou». Recueilli par Knud Rasmussen, adapté par Edward Field, op. cit., p. 47.
Tout ce que nous savons c’est que nous sommes des bêtes qui voulons tellement vivre que...
Adapté de «Faim» par Samik et rapporté par Knud Rasmussen. D’autres sources s’ajoutent à cette narration ainsi que des expériences personnelles.
Il est un fleuve inconnu. Tessimor, Paris, novembre 1991.
Jean MORISSET
Montréal / Nîmes,
octobre 1992 / juillet 1993