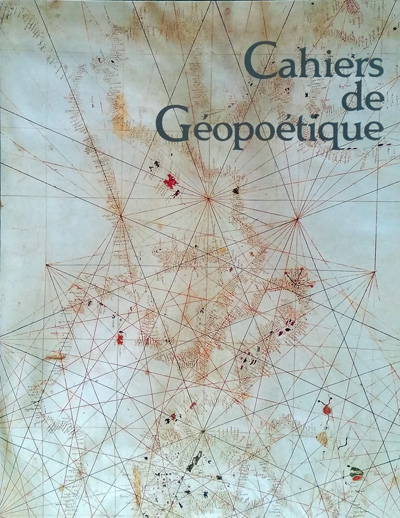AU SUJET DE QUELQUES SOURCES PHILOSOPHIQUES ET LITTÉRAIRES DE L’HOMME ET LA TERRE.
Passé presque inaperçu lors de sa première publication en 1952 [1], et écarté pendant longtemps, L’Homme et la Terre du géographe Éric Dardel a attiré nettement plus d’attention lors de sa réédition de 1990 [2]. Non seulement on peut y lire une sorte de pré-géopoétique mais on y trouve un champ référentiel analogue à celui que développe Kenneth White dans ses essais, notamment Le Plateau de l’Albatros, introduction à la géopoétique.
Aborder la question des sources d’inspiration de L’Homme et la Terre appelle à certaines qualités de modestie. Comment, en effet, tracer une filiation biographiquement sûre entre une œuvre puissamment imaginative et la vaste culture littéraire de Dardel ? Il est certes possible de relever des noms d’auteurs cités dans l’opuscule — j’en ai dénombré près d’une centaine — mais on ne résoudrait pas ainsi ce qui apparaît comme une énigme de création littéraire et géographique.
Le panorama documentaire de L’Homme et la Terre comprend des auteurs et des œuvres tels celles de Gaston Bachelard, J. de Castro, Christophe Colomb, la Bible, Mircea Eliade, Lucien Febvre, Heidegger, Stefan Georg, Hérodote, Hölderlin, Michelet, Leenhardt, Nietzsche, Élysée Reclus (lui aussi auteur d’un Homme et la Terre !), Rousseau, Sartre ou Saint-Exupéry, et j’en oublie. La valeur d’une telle énumération bibliographique ne doit cependant pas rendre dupe : un auteur s’inspire d’une famille culturelle dont les membres sont plus ou moins visibles. Ainsi que l’exprime G. Olsson [3], les mots sont rarement nouveaux ; ils sont vieux et hérités d’anciens textes et contextes, et ils se rapportent à d’autres mots. Dardel, il est vrai, ne craint pas le « déjà dit », mais à condition qu’il soit un « autrement dit ». Étudier l’héritage philosophique et littéraire de cette œuvre d’esthète et d’érudit renvoie aussi à des auteurs dont il n’est pas fait mention. Le poids de leurs idées, bien qu’indirectement repérable, n’en n’a pas moins pesé sur la phraséologie de l’auteur. Ces liens de parenté recouvrent aussi bien Platon que Hermann Hesse, en passant par Aristote, Dostoïevski et les romantiques européens. Ils forment une famille philosophiquement unie par l’affirmation de valeurs individuelles et contemplatives dans l’espace. Grâce peut-être à cet héritage de liberté, Dardel s’est fait sienne une leçon d’importance : devenir son propre maître, et sortir des sentiers académiques battus par la discipline. Des universitaires, certes, garnissent la fresque inspiratrice du poète-historien-géographe, mais ils furent généralement des créateurs marginaux plutôt que des scolastiques, et ils appartiennent à cette espèce de professeurs en voie de disparition, indépendante d’esprit, cultivée et humaniste. Faut-il voir en cela une des raisons de la désaffection de l’Établissement géographique à l’égard de Dardel, mû davantage par la poésie que par l’économie ou la politique ? L’Homme et la Terre est l’œuvre d’un écrivain, non celle d’un bureaucrate, d’un libre penseur plutôt que d’un agent des pouvoirs en place, d’un poète plutôt que d’un professeur aux idées convenues. Ici réside la cause du peu d’intérêt rencontré chez ses contemporains scientifiques en qui il ne trouve pas de maître à penser. S’il s’arrête à quelque texte de géographe ou d’historien, aux Îles Britanniques de Demangeon (cité p. 41-42), à L’Essai sur la formation du paysage rural français de Roger Dion parue en 1924 (cité p. 43), et, naturellement aux œuvres de Lucien Febvre et de Vidal de la Blache, c’est qu’il y décèle de la verve littéraire et de brillantes métaphores spatiales. L’amour de l’art autant que celui de la science illumine ces écrits. En effet, Dardel appartient d’abord aux créateurs de langage. Le ton exalté de L’Homme et la Terre ne trompe pas : le contra qu’il combat s’appelle la géographie exclusivement scientifique, économique, utilitariste, en un mot, la géographie apoétique. Nous y reviendrons.
Dardel étonne par sa profonde unicité philosophique. Imprégné par la pensée grecque, son ouvrage est platonicien par sa dialectique de miroirs et aristotélicien par le découpage des lieux qu’il opère, suivant la séparation logique des Quatre Eléments. Dardel s’inspire d’une tradition, de la grande tradition écrite tout court. Je renvoie à la question de l’herméneute Gadamer : « … comment, malgré la multiplicité de ces manières de dire, la même unité de penser et du parler se manifestent cependant partout et de telle manière que, par principe, toute tradition écrite peut être comprise [4] ». Le premier registre de l’hymne à la Terre touche la question de la désignation de celle-ci, une « écriture à déchiffrer » (p. 2). Chez Dardel, il y a une obsession du vocabulaire, de la juste terminologie géographique : « L’espace géographique est unique ; il a un nom propre : Paris, Champagne, Sahara, Méditerranée » (p. 3). Or, c’est Platon qui a, mieux que quiconque, développé le problème de la désignation des êtres et des choses dans son Cratyle [5]. Lors de la discussion avec Hermogène, Socrate dit qu’il y a des discours vrais et des discours faux. Or, si le discours est vrai ou faux, les parties le sont aussi, et le nom, qui est la plus petite partie du discours, peut donc être vrai ou faux [6]. Le rapport du mot à l’objet ou à l’entité spatiale qu’il désigne n’est jamais stable et définitif. Il évolue historiquement et suivant le point de vue adopté. La « Champagne » ou la « Méditerranée » de Dardel ne sont pas les miennes, mais le simple fait d’évoquer ces noms propres rapporte à un sens collectif, quasi archétypique, plongeant ses racines dans l’usage commun. Les changements d’appellation géographique, de noms propres, ne sont pas rares ; ils sont soumis aux caprices des vents politiques et culturels. Qui n’a vu des rues ou des nations changer de nom, et avec eux leur signification dans l’histoire ? Toutefois, l’on ne devrait pas oublier que les choses possèdent une existence en soi plus constante que leur désignation qui peut se montrer illusoire. Par exemple, la route des Acacias à Genève n’est bordée d’aucune essence de la sorte ; au contraire, c’est la rue la plus bétonnée et la moins romantique qui soit. Examinant la justesse des appellations — comme le fait Socrate dans le Cratyle — Platon conclut qu’il est plus commode d’en référer aux « choses éternelles », la nature, les dieux, les démons, les héros, le corps et l’âme de l’homme. Leur désignation est moins sujette à contestation, et Dardel l’a très bien compris. Il base son discours sur des faits quasi permanents qui ont acquis une terminologie stable. Que l’on nous permette une critique à cet égard : la géographie est aussi affectée par le flux incessant des choses ; tout n’est pas immobile et éternel.
L’urbanisation fournit la forme la plus spectaculaire des changements en cours sur la surface terrestre. Le chapitre portant sur « l’espace construit » y fait d’ailleurs discrètement allusion (on y parle de gigantisme tentaculaire). Toutefois, le contenu humain des villes n’est guère approfondi ; Dardel, à l’instar de la plupart des géographes classiques, n’aime pas la ville, c’est un homme du règne minéral, aquatique ou pastoral. Les étendues de sable, d’eau ou de glace l’inspirent davantage que ce produit douteux de la nature humaine, la ville. Dardel n’a pas lu les adeptes que l’on regroupera plus tard sous le label d’« École de Chicago [7] », et c’est dommage. De fait, Dardel poursuit la manière de Socrate : transposer des notions et des valeurs éternelles de la géographie, surtout des phénomènes naturels et leur mythologie cultu(r)elle ; le symbolisme mythique des espaces tellurique, aérien ou aquatique procède de cette démarche. La terminologie de son langage n’est jamais mise en question — ce serait ainsi un « discours vrai », dans le sens où le vocabulaire incorporé serait sans cesse reformulé dans une poésie créatrice.
La géopoétique de Dardel recèle des formes affectives du vocabulaire. Sous la notion transparaît la valeur : «Le langage du géographe sans effort devient celui du poète. Langage direct, transparent qui “parle” sans peine à l’imagination, bien mieux sans doute que le discours “objectif” du savant, parce qu’il transcrit fidèlement l’“écriture” tracée sur le sol » (p. 3). Cette question de la mimésis du vocabulaire calqué sur la nature des objets — ici le sol, là le ciel — est très subtilement éclairée dans le Cratyle. La mimésis entre le mot et l’objet ou l’être qu’il désigne n’est pas une simple relation de copie, explique Gadamer. « La simple imitation, “l’être comme” contient toujours la possibilité de faire naître la réflexion sur la distance ontologique qui sépare imitation et modèle [8]. » Cette distance ontologique apparemment réductible entre le mot et sa chose ou son être, cette fusion éphémère entre le mot et le monde, la poésie romantique l’a célébrée au plus haut point.
Novalis et Hölderlin occupent une place de choix dans le panthéon prophétique de L’Homme et la Terre. Quoi d’étonnant à ce que l’œuvre de Novalis [9], géologue et ingénieur des mines de formation, poète du règne minéral par excellence, « géographe de la pensée » qui fait le voyage en personne [10], ait fermenté dans l’esprit géographique de Dardel ? Novalis a poétisé la science jusqu’à l’extrême, il a animé de son expérience intérieure la « nature de la réalité géographique » et illuminé de son prodige des mythes collectifs vieillissants ; il nous fait découvrir la « valeur sous la notion » ainsi que le clame Dardel (p. 7). Novalis, comme le géographe français, descend de Platon en cela qu’il est essentiellement idéaliste. Cette « âme du monde » qui se réfugie dans les sanctuaires les plus secrets, dans les régions supérieures du cœur (p. 7), c’est à n’en pas douter le royaume des idées cher à Platon. Géographe de l’imaginaire, Novalis l’est également. Pour lui, « écrire est une extériorisation de l’état intérieur, l’expression de métamorphoses intérieures : l’apparition de l’objet intérieur. L’objet extérieur se change en concept en passant par et dans le moi, et ainsi est produite la vision personnelle des choses [11]. » L’imagination géographique est puissamment ancrée dans le moi. Les impressions géographiques de Dardel, qui accordent au point de vue le statut du moi en « position » ou en « situation », font la part belle à l’irréductibilité de la personne comprenant, sentant et rêvant le monde. Ce monde est celui de la beauté, recréé par la nature première de l’art, la transgression poétique. Dans ses Cahiers d’études philosophiques, Novalis note : « La poésie est pour les hommes ce que le chœur est dans la tragédie grecque : intervention de la belle âme, action rythmique — la voix d’accompagnement de notre moi en train de se développer — un passage au pays de la Beauté — partout une trace légère du doigt de l’humanité — libre règle — une victoire avec chaque mot sur la nature brute — dont l’humour, le jeu expriment la libre et indépendante activité — un envol — une humanisation — une élucidation — un rythme — un art [12]. »
Dardel est l’un des très rares géographes qui imprime à son langage une constante poétique. Grâce à l’emploi d’un vocabulaire émotionnel et affectif, il touche le cœur et l’âme de l’homme, centre d’une géographie évocatrice. Lorsque Dardel interpelle les « fleuves majestueux ou capricieux, les torrents fougueux, les plaines riantes, le relief tourmenté (p. 7), il transmet une langue géographique anthropomorphisée, sensible à l’appel de la sympathie terrestre. Ainsi qu’il l’explique, l’expérience de la terre, du fleuve, de la montagne ou de la plaine est d’abord qualifiante (p. 7). « Entre l’homme et la Terre, se noue et demeure une sorte de complicité dans l’être » (p. 8). Sans aller si loin dans la théorie que Novalis dans ses aphorismes ou l’existentiel Heidegger sur l’être et le temps, Dardel sait pourquoi il idéalise dans l’expression la relation amoureuse qu’il entretient avec la Terre : « Le monde doit être romantisé. Ainsi on retrouvera le sens originel. Romantiser, ce n’est pas autre chose qu’élever à une puissance qualitative. Le moi inférieur sera identifié dans cette opération avec un moi meilleur […]. Quand je donne aux choses communes un sens auguste, aux réalités habituelles un aspect mystérieux, à ce qui est connu la dignité de l’inconnu, au fini un air, un reflet, un éclat d’infini : je les romantise… [13]. »
Pour qualifier la Terre, l’humaniser dans le sens « auguste » du terme, Dardel romantise le langage géographique. Cette écriture sublimante ne manquera pas d’irriter les chercheurs à l’âme matérialiste et scientiste, pour lesquels toute romantisation est un mensonge, une prosternation devant le mythe et l’ignorance, une défaite de l’explication. Ce genre de reproche hyper-rationaliste touche en fait autant Dardel que Bachelard ou Novalis, qui restent attachés à la science, mais à une science consciente de ses limites et supérieure en rien à la poésie ou à la philosophie. Pour Novalis, science et poésie s’associent et se fécondent mutuellement : « La forme parachevée des sciences doit être poétique. Chaque phrase, chaque principe doit avoir un caractère original, doit manifester une individualité indépendante et toute naturelle ; il faut qu’il soit l’enveloppe de quelque idée imprévue, amusante [14]. » Dardel, qui semble s’inspirer de ce précepte, fait-il œuvre de « pré-science », accusation qui a grevé une partie de la phénoménologie ? « Connaître l’inconnu, atteindre l’inaccessible, l’inquiétude géographique précède et porte la science objective. » (P. 1.) En abordant la question de la légitimité scientifique d’une géographie littéraire et poétique, nous ferons référence aux existentialistes et à leur conception de la science. Si Dardel cite les travaux de psychologie existentielle des années 1920 et 1930 de Max Scheler et de Minkovski, il s’inspire directement des vues philosophiques de Jaspers et de Heidegger. Peut-être a-t-il également dans l’esprit une conception goethéenne de la science.
« La géographie, en saisissant la réalité du monde en tant que spatiale et l’espace en tant que visage de la Terre, exprime une inquiétude fondamentale de l’homme. Elle répond à un intérêt existentiel que ne peut éteindre le dessein d’investir l’homme comme objet de connaissance ; se mettre en dehors de la Terre et de l’espace concret pour les connaître du dehors, c’est oublier que, par son existence même, l’homme est engagé comme être spatial et comme être terrestre ; elle est donc ce que Karl Jaspers appelle une science-limite, comme la psychologie et l’anthropologie, une science dont l’objet reste, dans une certaine mesure, inaccessible, parce que le réel dont elle s’occupe ne peut être entièrement objectivé » (p. 124). Karl Jaspers assignait à la science sociale un rôle beaucoup plus modeste que le laisse présager Dardel, qui a hérité de la géographie classique une conception synthétique de notre discipline, exaltante dans sa démesure. Dans Raison et Existence (que ne cite pas expressément Dardel), Jaspers admet que la science humaine est impuissante à pénétrer l’être dans sa dimension essentiellement transcendantale : « Elles (l’anthropologie, la psychologie, la sociologie et les autres sciences humaines) étudient les phénomènes humains dans le monde mais de telle sorte que ce qu’elles découvrent n’est jamais la réalité englobante de cet être qui, non reconnu comme tel, est pourtant chaque fois présent. Aucune histoire ou sociologie de la religion, par exemple, n’atteint ce qui, dans ce qu’elles nomment religion, était dans l’homme l’existence même de celui-ci […]. Toutes ces sciences tendent à quelque chose qu’elles n’atteignent jamais. Elles ont ce caractère fascinant d’avoir à faire avec ce qui est vraiment important. Elles induisent en erreur quand elles pensent, dans leur activité immanente qui constate et déduit saisir l’être même […]. Leur prestige est mensonger, mais il devient fécond quand, par elles, se produit la connaissance modeste, relative, indéfinie, de notre phénomène dans le monde [15]. »
Où se situe la limite de la science humaine dans les domaines de l’être et de l’existence ? Dardel repousse cette limite le plus loin possible ; c’est pourquoi il emprunte largement à la philosophie, ce « poème de l’intelligence (la sagacité) » comme l’écrivait Novalis [16]. Toutefois, ainsi que le notait ce dernier, la philosophie est incomplète sans la poésie, car celle-ci « élève chaque élément isolé par une connexion particulière avec le reste de l’ensemble, le tout [17] » ; la poésie est la clef de la philosophie. Les références poétiques abondent dans L’Homme et la Terre, et il ne faut pas prendre à la légère les dernières notes de cette symphonie géographique, un poème de Stefan Georg :
Par quels charmes ont souri ces matins de la Terre
Tels qu’à leur premier chant ? Chant d’une âme étonnée
De mondes rajeunis et que porte le vent
Le vieux profil des monts a changé de visage
Comme aux vergers de l’enfance on voit flotter des fleurs
La nature frémit du frisson de la Grâce… (p. 133).
Le langage de L’Homme et la Terre atteint à la musicalité et rend toute conceptualisation scientifique laborieuse. Comment la science humaine peut-elle voisiner avec la musique, la première étant l’opposé de la seconde en matière d’explicitation conceptuelle ? L’on aura beau « expliquer » une mélodie ; celle-ci ne gagnera ni en beauté ni en style. Et pourtant, le langage de Dardel ne manque ni de précision ni de subtilité, mais il se refuse à toute construction conceptuelle nouvelle. Certes, des déductions sont tirées a priori ainsi que des abstractions constituées : la division épistémologique des quatre éléments de la nature (l’air, l’eau, la terre, le feu) est la première convention déductive que la géographie ait utilisée. L’on revient aux Grecs, au Cratyle de Platon, pour saisir le sens et la portée de tels concepts très généraux que Dardel développe par la suite avec la grâce du chant poétique.
Socrate prouve à Cratyle, qui prétend que tous les noms sont justes, que le nom, étant une image de l’objet qu’il désigne, peut, tout comme l’image du peintre, être plus ou moins exact, qu’il doit même être inexact, ou du moins incomplet, sous peine de ne plus se distinguer de l’original : « … il suffit que le caractère général de cet original y soit reconnaissable et que les inexactitudes de détail n’empêchent pas les gens de s’entendre sur la signification d’un nom… [18]. » La création du langage doit faire une part assez large à la convention, pour que celui-ci soit fécond et compris. La clarté de la langue de Dardel, de même que ses approximations et ses inexactitudes passagères, semblent s’adresser à cette conception platonicienne de la langue naturelle, version contestée par l’art et la science modernes. Mais qui a dit que Dardel était moderne ?
Dardel n’est pas un moderne, mais il a introduit ce que Bachelard appelait une « différentielle de nouveauté » dont tout créateur peut se prévaloir. Dans la préface de La Terre et les Rêveries de la volonté [19], commune à La Terre ou les Rêveries du repos [20], le philosophe disserte sur le principe de l’imagination matérielle et langagière. Les quatre éléments, l’eau, l’air, la terre et le feu sur lesquels repose en grande partie l’épistémologie dardélienne sont les « quatre éléments matériels que la philosophie et les sciences antiques continuées par l’alchimie ont placés à la base de toutes choses [21] ». Leurs fonctions archétypiques dans la littérature et la poésie fourniront la base épistémologique des analyses érudites de Bachelard, et Dardel leur assure une continuité dans l’histoire de la géographie. Bachelard, auteur le plus fréquemment cité avec l’historien des religions Mircea Eliade, a nourri de nombreuses pages de Dardel. Sa langue, très française dans son style, fine et cartésienne, poétique mais rationnelle, n’a pas abandonné l’espoir de se constituer en science ; elle se rapproche parfois de celle de Dardel. Le découpage du chapitre premier de L’Homme et la Terre ressemble de près aux divisions épistémologiques opérées par Bachelard dans ses ouvrages successifs portant sur les quatre éléments. Ainsi La Terre et les Rêveries du repos [22] a-t-elle inspiré plusieurs passages du chapitre intitulé « L’espace tellurique » ; L’Eau et les Rêves [23] se sont en partie projetés dans « L’espace aquatique », alors que « L’espace aérien » célébrant la psychologie de l’élévation et de la légèreté est animé de la même poésie nietzschéenne que L’Air et les Songes [24].
Le rôle de l’« image imaginée » que Bachelard oppose à « l’image perçue » sortira grandi du discours sublimé de Dardel sur la réalité géographique. En affirmant que « les images imaginées sont des sublimations des archétypes plutôt que des reproductions de la réalité [25] », Bachelard renvoie à Novalis (« de l’imagination productrice doivent être déduites toutes les facultés, toutes les activités du monde intérieur et du monde extérieur [26] »). Cette conception procède de l’idéalisme subjectif cher à Platon.
C. G. Jung n’est curieusement jamais cité par Dardel, mais celui-ci ignore-t-il celui-là ? Jung a clairement montré comment la culture participe d’un renouvellement permanent des archétypes inconscients. Sur ce point, Dardel a suivi Bachelard qui considère « l’image dans son effort littéraire [27] », faite de fougue, d’exaltation et de rêverie sublimée. L’Homme et la Terre est le fruit d’une rêverie profonde non dans le sens péjoratif que lui donne parfois l’expression courante, mais au sens noble, qui transforme le pouvoir onirique en création langagière. « La réalité géographique exige parfois durement le travail et la peine des hommes. Elle le borne et l’enferme, l’attache “à la glèbe”, horizon étroit imposé par la vie ou la société à ses gestes et à ses pensées. La couleur, le modelé, les senteurs du sol, le décor végétal se mêlent aux souvenirs, à tous les états affectifs, aux idées, même à celles que l’on croit les plus émancipées. Mais cette réalité ne prend corps que dans une irréalité qui la dépasse et la symbolise. Son “objectivité” s’enracine dans une subjectivité, qui n’est pas pure fantaisie. Qu’on le nomme rêverie ou piété, un élément soulève la réalité concrète de l’environnement au-dessus d’elle-même, dans un au-delà du réel, et, alors, le savoir se résigne sans peine à un non-savoir, à un mystère » (p. 46-47).
Nous pourrions disserter encore sur les parentés culturelles unissant Dardel aux existentiels allemands, à la pensée mythique et religieuse revue par Mircea Eliade, mais nous ne parviendrions jamais à lever complètement le voile sur ce poème d’amour qu’est L’Homme et la Terre. Un interprète ne doit jamais sonder le cœur du poète ni emprisonner son esprit dans des catégories dogmatiques. « Cet art d’“interpréter” est un jeu de l’intellect, un jeu parfois très amusant, destiné à des personnes avisées mais étrangères à l’art, à des gens qui lisent et écrivent des livres […] mais qui ne trouvent jamais le moyen d’accéder au cœur d’une œuvre d’art parce qu’ils s’arrêtent à l’entrée et essaient toutes sortes de clés sans s’apercevoir que la porte est déjà ouverte [28]. »
Au lecteur de pénétrer à présent à l’intérieur du sanctuaire le plus précieux que la géographie ait conçu depuis des décennies !
Bertrand LÉVY
COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE
Sur la réception de L’Homme et la Terre par les géographes, on lira :
— Jean-Bernard Racine, « De l’être et du phénomène dans la pratique de la géographie. Récurrences épistémologiques à la lecture de Dardel », Genève, Géorythmes 4, 1986, p. 7-23.
— Claude Raffestin, « Pourquoi n’avons-nous pas lu Éric Dardel », Cahiers de géographie du Québec, v. 31, n° 84, déc. 1987, p. 471-481.
[1] Eric Dardel, L’Homme et la Terre. Nature de la réalité géographique, PUF, Paris, Nouvelle Encyclopédie philosophique, 1952.
[2] Nouvelle édition présentée par Philippe Pinchemel et Jean-Marc Besse, Éditions du Comité des Travaux historiques et scientifiques (CTHS), Paris, 1990.
[3] Gunnar Olsson, « Creativity and Socialization », Conférence sur « Innovation et Société », Nordiska institutet för samhällsplanering, Stockholm-Uppsala, 25-28 nov. 1984, p. 5.
[4] Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique. Trad. de l’allemand par E. Sacre, 1976, p. 251 *(1e éd. 1960). *Editeur ?
[5] Platon, Cratyle (ou sur la justesse des noms, genre logique), écrit vers 385 av. J.-C., trad. et présenté par E. Chambry, Paris, Garnier-Flammarion, p. 377-473.
[6] Ibid. p. 377.
[7] L’École de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine (recueil), trad. de l’allemand et de l’anglais par Y. Grafmeyer et I. Joseph, Paris, Aubier, 1979.
[8] H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, op. cit., p. 260.
[9] Novalis, Œuvres complètes, édition établie et traduite par A. Guerne, Paris, Gallimard, 1975, 2 vol. *(1802).
[10] A. Guerne, « Introduction » à Novalis, id. supra, p. 9.
[11] Novalis, Œuvres complètes, Cahiers d’études philosophiques (1795-1796), vol. II, p. 13.
[12] Novalis, Œuvres complètes, p. 14.
[13] ibid., p. 66, n° 97.
[14] ibid., p. 52, n° 17.
[15] Karl jaspers, Raison et existence, Cinq conférences, trad. de l’allemand par R. Givord, Presses Universitaires de Grenoble, 1978, p. 59-60.
[16] Novalis, op. cit., vol. II, p. 55, n° 28.
[17] ibid, p. 55, n° 29.
[18] Platon, Cratyle, op. cit., p. 383.
[19] Gaston Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 1947.
[20] id., La Terre et les Rêveries du repos, Paris, José Corti, 1948.
[21] id., La Terre et les Rêveries de la volonté, op. cit., p. 1.
[22] id., ibid.
[23] id., L’Eau et les Rêves, Paris, José Corti, 1942.
[24] Gaston Bachelard, L’Air et les Songes, Paris, José Corti, 1943.
[25] id., La Terre et les Rêveries de la volonté, op. cit., p. 4.
[26] Ibid., p. 4.
[27] Ibid., p. 7.
[28] Hermann Hesse, « Lettre à un jeune lecteur de Kafka, 9.1.1956 », in Lettres (1900-1962), trad. de l’allemand par E. Beaujon, Paris, Calmann-Lévy, 1981, p. 198.