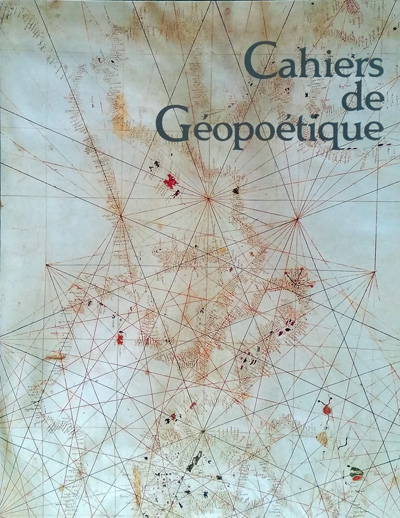Le 1er avril 1801, venu de l’île de Cuba, Alexandre de Humboldt se trouvait à Carthagène des Indes, sur la côte de la Nouvelle Grenade (la Colombie actuelle). Il écrit alors à son frère Guillaume:
«Si tu as reçu ma dernière lettre de La Havane, tu dois savoir que j’ai modifié mon plan initial et qu’au lieu d’aller dans l’Amérique du Nord à Mexico je suis revenu aux côtes méridionales du Golfe du Mexique pour voyager de là vers Quito et Lima. Il serait trop long de t’expliquer toutes les raisons...»
Au moment où il écrivait cette lettre, Humboldt était déjà bien engagé dans son immense «voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent», qui avait débuté le 5 juin 1799 et allait se poursuivre jusqu’au 3 août 1804.
C’est ce voyage-là que je qualifie de «pérégrination géopoétique». Je vais essayer de dire la raison d’être de ce voyage, toutes ses raisons d’être - autrement dit, je vais essayer de dégager sa logique totale. Je dirai aussi la raison pour laquelle Je l’appelle «géopoétique». Mais un mot d’abord quant à l’usage respectif du singulier et du pluriel dans mon titre et dans mon texte. En disant «pérégrinations géopoétiques» au pluriel, je pense moins à d’autres voyages effectués par Humboldt (notamment en Asie Centrale) qu’aux prolongations de ce même voyage en Amérique Equinoxiale - aux pistes diverses qu’il ouvrit dans l’esprit de Humboldt. En effet, le voyage américain parcourt toute la vie de Humboldt, à l’instar de la grande cordillère continentale qui s’étend entre l’Alaska et la Terre de Feu. Humboldt allait passer trente ans à en publier les résultats, en une trentaine de volumes. Dans ces livres, ainsi que dans quelques autres (Tableaux de la nature, Cosmos), il allait tenter, à partir de l’expérience du voyage dans le nouveau continent, d’ouvrir un nouveau champ intellectuel et poétique, disons, un nouveau monde.
Humboldt naît en 1769, en terre prussienne. Du côté paternel, son grand-père avait été capitaine, et son père était à la fois commandant de l’armée et chambellan du prince impérial. Du côté maternel, il y a une ascendance française et écossaise, parmi laquelle se trouve un protestant émigré du Gard dénommé Jean Colomb...
Au château de Tegel, résidence berlinoise de la famille, le jeune Alexandre reçoit, d’abord par l’intermédiaire de précepteurs, une excellente éducation, marquée à la fois par l’Aufklärung allemande, l’encyclopédisme français et le romantisme naissant. Cela donne lieu chez lui à une clarté d’esprit, une vigueur de pensée, un encyclopédisme éclairé, un élan transnational (il parlera de «peuples qui se croient aborigènes parce qu’ils ignorent leur filiation») - et un désir d’unité. Mais sans facilité, sans régression intellectuelle ou psychologique. Par exemple, toute religion, à ses yeux, consiste en un traité de mœurs (souvent admirable), un rêve géologique (genèse, etc.), et un «petit roman historique». Quant à la croyance à l’immortalité de l’âme, c’est tout bonnement «un conte bleu». A cette base par ailleurs si prometteuse, il manque pourtant un élément: le bonheur. Le père du jeune Humboldt meurt quand celui-ci a dix ans, et l’enfant souffre d’un manque d’affection de la part de sa mère - à l’âge de vingt-trois ans, évoquant les années passées à Tegel, il parlera de sa «triste existence».
Le voyage, qui va prendre une telle importance dans la vie de Humboldt, est d’abord pour lui un moyen de sortir de ce contexte malheureux. Mais le désir initial est renforcé par des lectures, des images: le récit de l’expédition accomplie par Vasco Nuñez de Balboa qui, le premier d’entre les Européens, put contempler des hauteurs de Quarequa, dans l’isthme de Panama, la partie orientale de la mer du Sud; la forme de la mer Caspienne vue sur une carte; un tableau des rives du Gange; un arbre des tropiques vu dans le jardin botanique de Berlin... L’idée de voyage est déjà forte en lui quand, après être passé par les universités de Francfort et de Göttingen, il rencontre. Georg Forster, géographe, écrivain, professeur, qui avait participé au deuxième voyage de Cook autour du monde (1772-1775), et dont les descriptions de Tahiti avaient éveillé dans tout le nord de l’Europe plus que de la curiosité: une convoitise géographico-érotique. Liés d’amitié, Forster et Humboldt partent ensemble pour l’Angleterre et la France. En plus de l’excitation du voyage, il y a de l’idéalisme politique dans l’air, il souffle un vent de liberté - à Paris, Humboldt transporte lui-même du sable pour le «temple de la liberté», encore inachevé. Ces espoirs politiques vont être déçus: Forster meurt à Paris, désespéré, en 1794. Plus tard, Humboldt verra Napoléon rétablir l’esclavage et parlera d’une stagnation de l’état social. Mais, laissant de côté le cycle de l’espoir, de l’agitation et de la déception, il sait qu’il a une œuvre à accomplir, une œuvre fondamentale et de longue haleine.
Au début des années 1790, il est à l’Académie de commerce de Hambourg. Ensuite, on le trouve à l’Académie des mines de Freiberg, dont il sort diplômé en 1792. Il a déjà fait ses premiers travaux de botanique, de chimie et de minéralogie, et une première carrière (mais il ne perd pas de vue son idée de grand voyage) semble toute tracée: dès sa sortie de l’Académie des mines, il est assesseur du Département des mines et fonderies de Prusse; trois ans plus tard, il est conseiller supérieur des mines. Tout cela peut sembler peu «poétique». Mais n’oublions pas la première carrière, assez semblable, de Novalis: une grande partie du romantisme sort de la géologie (strates) et de ce que Humboldt appelle la géognose (configuration du terrain),
De toute façon, pour Humboldt, ce passage dans les profondeurs de la terre ne fut qu’une étape. Bientôt, il allait retrouver l’air libre et l’étendue. En 1796 survient la mort de sa mère et il reçoit sa part d’héritage: 312 000 francs or - de quoi réaliser pleinement son rêve de voyage. En 1797 il écrit: «Mon voyage est irrémédiablement décidé. Je me prépare encore pendant quelques années et je rassemble les instruments. Je séjourne en Italie un an ou un an et demi, pour me familiariser avec les volcans. Puis on ira en Angleterre en passant par Paris. Et ensuite, en route vers les Indes Occidentales.»
Notons qu’il ne s’agit absolument pas, dans le voyage ainsi conçu, d’une aventure, d’un vagabondage, mais d’un plan de travail, d’un plan de vie.
Humboldt continue ses études: astronomie, chimie, minéralogie, galvanisme, botanique. En 1798, il est à Paris pour s’entretenir avec des savants français. Il y rencontre Aimé Bonpland, originaire de La Rochelle, qui sera son compagnon de route au cours du grand voyage équinoxial. Et il commence à envisager des itinéraires. Bougainville lui propose un voyage autour du monde, organisé par le Directoire: première année, le Paraguay et la Patagonie; deuxième année, le Pérou, le Chili, le Mexique, la Californie; troisième année, les mers du Sud; quatrième année, Madagascar; cinquième année, la Guinée. Il est prêt à partir, mais le projet est annulé, faute de crédits. Il part à Marseille, décidé à s’embarquer, coûte que coûte: «Je voulais passer l’hiver en Algérie et dans l’Atlas où il y a encore dans la province de Constantine, d’après Desfontaines, 400 plantes inconnues. De là, je voulais rejoindre Bonaparte par Sufetula, Tunis et Tripoli, avec la caravane qui va à La Mecque.» Il attend deux mois mais la frégate qu’il attendait fait naufrage. Il essaie de partir pour Tunis, mais le bey d’Alger suspend le trafic maritime. Il quitte Marseille et, avec Bonpland, longe la côte méditerranéenne: Catalogne, Tarragone, Balaguer, Valence... A Madrid, il finit par obtenir, chose rare, un passeport pour les colonies espagnoles d’Amérique. Départ alors pour la Corogne, où les deux compagnons s’embarquent pour le Venezuela.
«Quel bonheur... ma tête en tourne de joie... Quel trésor d’observations vais-je pouvoir faire pour enrichir mon travail sur la construction de la terre... Je collectionnerai des plantes et des fossiles et je pourrai faire des observations astronomiques, avec des instruments excellents... Mais tout cela n’est pas le but principal de mon voyage. Mon attention ne doit jamais perdre de vue l’harmonie des forces concurrentes, l’influence de l’univers inanimé sur le règne animal et végétal.»
Je souligne ces deux dernières phrases. Car nous avons là la première formulation de ce qui est véritablement en jeu. Si, dans le voyage de Humboldt, il ne s’agit pas d’une simple aventure, il ne s’agit pas non plus d’une simple expédition scientifique. Son plan de travail a plusieurs strates, il est ouvert à des configurations inédites. Au sommet, on trouve une conception de l’harmonie, une esthétique, celle qu’il vient d’évoquer. Au fond, à la base de toutes ses recherches, il y a une recherche du bonheur. Le 16 juillet 1799, à Cumana, péninsule d’Araya, Humboldt écrit: «Nous sommes ici, enfin, dans le pays le plus divin et le plus merveilleux. Des plantes extraordinaires, des anguilles électriques, des tigres, des tatous, des singes, des perroquets et de nombreux, très nombreux Indiens purs, à demi sauvages, une race d’hommes très belle et très intéressante... Depuis notre arrivée, nous courons partout comme des fous... Je sens que je serai heureux ici.» Le savoir est lié à l’être, l’être est lié à l’environnement, et ce champ complexe peut être le lieu d’une transcendance.
Il n’est pas dans mon propos de raconter tout le voyage. Je relèverai seulement quelques points et quelques passages.
Le premier point à noter, peut-être, c’est que, à l’encontre de beaucoup d’expéditions plus modernes, Humboldt n’insiste jamais sur le côté «exploit» (moral ou technique) de son voyage. Que la progression ait été très difficile par endroits, c’est certain. Dès le début, Humboldt évoque avec humour la route de Cumana à Caracas: «Le chemin de terre de Cumana à Nueva Barcelone, et de là à Caracas, est à peu près dans le même état qu’avant la découverte de l’Amérique.» Il faut imaginer un terrain fangeux, des blocs de rochers épars, une végétation dense, des torrents et des traverses, ainsi que des porteurs (dix, quinze, vingt-cinq) et des bêtes de somme (ici, deux bœufs, là, vingt mulets) chargés d’instruments et de provisions. Il faut imaginer une absence presque totale de cartographie: «Ces contrées sont si sauvages et si peu fréquentées qu’à l’exception de quelques rivières, les Indiens ignoraient le nom de tous les objets que je relevais à la boussole - aucune observation d’étoile ne me rassurait sur la latitude, dans une distance d’un degré.» Il faut imaginer une pirogue, de quarante pieds de long sur trois de large, qui n’était en fait qu’un tronc d’arbre creusé par le double moyen de la hache et du feu. Au moindre mouvement imprévu et non annoncé, le tout - hommes et caisses de collections - risquait de chavirer. Ajoutez à cela le fait que Humboldt risqua sa vie plus d’une fois, notamment au volcan de Pichincha, où, pour faire ses observations, il s’établit «sur une pierre qui, étant soutenue par un côté seulement et minée par en dessous, s’avançait en forme de balcon sur le précipice». Mais très peu de tout cela dans le récit. Humboldt ne s’intéresse pas à l’exploit, il s’intéresse à la connaissance. A propos de Horace Bénédict de Saussure (Voyage dans les Alpes, 1779), qu’il salue en passant comme «le plus grand savant et le plus intrépide des voyageurs», il écrit, et c’est peut-être une critique implicite: «Ces excursions pénibles, dont les récits excitent généralement l’intérêt du public, n’offrent qu’un très petit nombre de résultats utiles au progrès des sciences.» Et on peut aller encore plus loin. Humboldt, scientifique, féru de connaissances exactes, regrette l’alourdissement du voyage qu’entrame l’intention scientifique: «Lorsque, chargé d’instruments de physique et d’astronomie, on a terminé des voyages de quelques milliers de lieues à travers des continents, on est tenté de dire, à la fin de sa carrière: heureux ceux qui voyagent sans instruments qui se brisent, sans herbiers exposés à se mouiller, sans collections d’animaux qui se dégradent. Heureux ceux qui parcourent le monde pour le voir de leurs yeux, tâcher de le comprendre, recueillir les douces émotions que fait naître l’aspect de la nature, dont les jouissances, plus simples, sont aussi plus calmes et moins sujettes à être troublées.» Mais on peut aussi ne pas accepter son alternative: d’un côté, du compliqué; de l’autre, du simple. On peut accepter, d’abord, le compliqué, comme ouverture, si je puis dire, des premiers plis. Ensuite, comme on est souvent obligé de le faire en terrain étranger, utiliser ces premières études comme des traductions, première étape vers une compréhension, et vers une expression, de l’esprit profond.
Le 7 février 1800, Humboldt quitte Caracas pour Puerto Caballo, sur la côte Caraïbe. De là, il descend vers San Fernando, sur l’Apure, un affluent de l’Orénoque. Il remonte alors l’Orénoque jusqu’à Rio Negro, aux confins du Brésil, puis revient à l’Orénoque par le Casiquare. En somme, soixante-quinze jours, deux mille deux cents kilomètres, consacrés à des collectes de «spécimens», à des mesures barométriques, thermométriques, trigonométriques, astronomiques, etc., et à son journal. Premier point à noter ici, une sensation de bien-être: «Je suis créé pour les Tropiques... jamais je n’ai été si constamment bien portant... j’ai séjourné dans des villes où la fièvre jaune faisait rage et jamais je n’ai eu le moindre mal de tête.» Il y a le bien-être intérieur, et il y a l’approche de l’extérieur. Voici Humboldt évoquant les llanos (les steppes) au sud de Caracas: «L’aspect du pays est toujours le même. Il ne faisait pas clair de lune, mais les grands amas de nébuleuses, qui ornent le ciel astral, éclairaient, en se couchant, une partie de l’horizon terrestre. Ce spectacle imposant de la voûte étoilée, qui se présente dans son immense étendue, cette brise fraîche qui parcourt la plaine pendant la nuit, ce mouvement ondoyant de l’herbe partout où elle atteint quelque hauteur, tout nous rappelait la surface de l’Océan. L’illusion augmentait surtout (on ne se lasse pas de le dire) lorsque le disque du soleil montait à l’horizon, répétait son image par l’effet de la réfraction, et, perdant bientôt sa forme aplatie, montait rapidement et droit vers le zénith.» On remarquera dans ce texte plusieurs éléments: en tout premier lieu, une sensation astronomico-tellurique; ensuite la juxtaposition de sensation brute et d’explication scientifique («effet de réfraction»), sans qu’un amalgame satisfaisant ait encore été trouvé; et finalement, le plaisir de l’expression, et même de la répétition («on ne se lasse pas de le dire»), Voici un autre texte, qui parle des cataractes de Maypures:
«Il y a là un point d’où l’on découvre un horizon merveilleux. L’œil embrasse une surface écumante qui a près de deux lieues d’étendue. Du milieu des flots s’élèvent des rochers noirs comme le fer et semblables à des tours en ruine. Chaque île, chaque pierre est ornée d’arbres qui poussent des rameaux vigoureux: un nuage épais flotte constamment au-dessus du miroir des eaux, et, à travers cette vapeur d’écumes, s’élancent les hautes cimes des palmiers Mauritia. Lorsque, le soir, les rayons ardents du soleil viennent se briser dans le nuage humide, des effets de lumières produisent un spectacle magique. Des arcs colorés s’évanouissent et reparaissent tour à tour; leurs images vaporeuses flottent au gré des airs.
Tout autour, sur le dos nu des rochers, les eaux murmurantes ont amassé, durant la longue saison des pluies, des îles de terre végétale, ornées de mélastomes et de drosères, de fougères et de petites mimoses au feuillage argenté, ces îles forment des lits de fleurs au milieu des rochers nus et désolés. Elles réveillent chez l’Européen le souvenir de ces blocs de granit appelés courtils par les habitants des Alpes, qui, couverts de fleurs, s’élèvent isolément au milieu des glaciers de la Savoie.
A l’horizon bleuâtre, l’œil se repose sur la chaîne de Cunavami, formée par des dos de montagnes qui se prolongent au, loin et se terminent brusquement en un cône tronqué. Ce cône, nommé par les Indiens Calitamini, nous apparut au coucher du soleil comme une masse embrasée. Le même phénomène se reproduit chaque soir. Personne ne s’est jamais approché de cette montagne. Peut-être l’éclat dont elle brille tient-il à des jeux de lumière produits par les reflets du talc ou du schiste micacé.
Durant les cinq journées que nous passâmes dans le voisinage des cataractes, nous reconnûmes avec surprise que le bruit de la masse d’eau qui tombe est trois fois plus fort la nuit que le jour. On remarque le même phénomène dans les chutes d’eau de l’Europe; mais à quelle cause l’attribuer dans un désert où rien n’interrompt le repos de la nature? Sans doute à des courants ascendants d’air chaud qui, par le trouble qu’ils apportent dans l’équilibre de l’élasticité atmosphérique, empêchent le son de se propager et en brisent irrégulièrement les ondulations. La fraîcheur de la nuit met fin à ces courants.»
Là encore, sensations fortes et fines, vocabulaire technique précis (palmiers Mauritia, mélastomes, drosères...), mais vocabulaire «globalisant» peu satisfaisant: merveilleux, magique... Autre exemple, cette vision «géognostique» d’une autre partie de l’Orénoque:
«L’aspect géographique de cette contrée, la forme des rochers de Kéri et d’Oco, qui ressemblent si bien à des îles, les excavations creusées par les eaux dans la première de ces collines, et qui sont placées exactement au même niveau que celles de l’île Ouivitari, située à l’opposite, toutes ces apparences prouvent que l’Orénoque remplissait autrefois la baie laissée aujourd’hui à sec. Vraisemblablement, les eaux formèrent un vaste lac, aussi longtemps qu’elles furent arrêtées par la digue du nord. Lorsque cet obstacle fut renversé, la savane habitée aujourd’hui par les Indiens Guareca sortit du milieu des eaux. Peut-être le fleuve entoura-t-il longtemps encore les rochers de Keri et d’Oco, qui, s’élevant du côté de l’ancien lit comme des tours bâties sur une montagne, présentent aux regards un spectacle très pittoresque. Les eaux, en s’abaissant peu à peu, finirent par se retirer vers la chaîne de montagnes qui les borde du côté de l’orient.
Plusieurs circonstances confirment cette supposition. L’Orénoque, en effet, a, comme le Nil près de Philae et de Suez, la remarquable propriété de colorer en noir les masses granitiques d’un blanc rougeâtre, qu’il lave depuis des milliers d’années. Partout où les eaux peuvent atteindre, on remarque sur les rochers qui bordent les rives une couche grise, contenant du manganèse et peut-être du carbone, qui pénètre à peine d’un dixième de ligne à l’intérieur de la pierre. Cette couleur noire et les cavités dont nous parlions plus haut marquent encore l’ancien niveau de l’Orénoque.
Dans le rocher de Keri, entre les îles des Cataractes, dans les collines de gneiss de Cumadaminari qui courent au-dessus de l’île Tomo, enfin à l’embouchure du Jao, ces cavités noirâtres sont élevées de 49 à 59 mètres au-dessus de la surface actuelle des eaux. Leur existence nous apprend (ce qui, du reste, peut être remarqué en Europe dans tous les lits des fleuves) que les courants dont la grandeur excite aujourd’hui notre admiration ne sont que de faibles restes des énormes masses d’eau qui existaient dans les temps anté-historiques.
Des observations aussi simples n’ont pas échappé aux indigènes grossiers de la Guyane. Partout les Indiens nous faisaient remarquer les traces de l’ancien niveau. On voit même dans une plaine de graminées, près d’Uruana, un rocher de granit isolé, sur lequel, d’après le récit d’hommes dignes, de foi, sont creusées profondément à une hauteur de 26 mètres des images qui semblent disposées par rangées et qui représentent le soleil, la lune et différentes espèces d’animaux, surtout des crocodiles et des boas. Personne, aujourd’hui, ne pourrait atteindre sans échafaudage aux flancs abrupts de ce rocher, qui mérite l’attention la plus scrupuleuse de la part des voyageurs à venir. Les caractères hiéroglyphiques gravés sur les montagnes d’Uruana et d’Encaramada sont également placés à des hauteurs inaccessibles...
L’extrémité septentrionale des cataractes attire l’attention par des images naturelles, représentant, dit-on, le soleil et la lune. Le rocher Keri... tire en effet son nom d’une tache blanche qui resplendit au loin, et dans laquelle les Indiens ont cru reconnaître une ressemblance frappante avec le disque de la pleine lune. Je n’ai pu gravir les flancs escarpés de ce rocher, mais je suppose que la tache blanche provient d’un nœud de quartz considérable, formé par la rencontre de filons croiseurs, qui se détachent sur le granit d’un noir grisâtre.»
Comme pour les autres textes cités, on notera la précision du détail, l’insuffisance du vocabulaire global («un spectacle très pittoresque») et ce trait des lumières que j’aime, tant les voyageurs en pays exotiques sont prêts à gober le premier «mystère» venu, prêts à humer voluptueusement le dernier relent rance du «sacré», ce trait qui consiste à traduire la lune du rocher Keri par une tache blanche provenant d’un nœud de quartz considérable. Ailleurs, en pays Inca, il précisera que le soi-disant sang d’Atahualpa qu’on est censé voir sur une pierre est en fait «des agrégations d’amphibole et pyroxène formées naturellement dans la pierre».
Humboldt «démystifie» donc, tout en étant prêt, car il sait que le domaine de la fable peut receler des vérités, à se pencher sur les images gravées de main d’homme dans tel rocher granitique. Mais poursuivons notre route. Voici l’évocation du «superbe Orénoque» lui-même:
«En sortant du Rio Apure, nous nous trouvâmes dans un pays d’un aspect tout différent. Une immense plaine d’eau s’étendait devant nous, comme un lac, à perte de vue. Des vagues blanchissantes se soulevaient à plusieurs pieds de hauteur par le conflit de la brise et du courant. L’air ne retentissait plus des cris perçants des hérons, des flamants et des spatules qui se portent en longues files de l’une à l’autre rive. Nos yeux cherchaient en vain de ces oiseaux nageurs dont les ruses industrieuses varient dans chaque tribu. La nature entière paraissait moins animée. A peine reconnaissions-nous dans le creux des vagues quelques grands crocodiles fendant obliquement, à l’aide de leurs longues queues, la surface des eaux agitées. L’horizon était bordé par une ceinture de forêts; mais nulle part ces forêts ne se prolongeaient jusqu’au lit du fleuve. De vastes plages, constamment brûlées par les ardeurs du soleil, désertes et arides comme les plages de la mer, ressemblaient de loin, par l’effet du mirage, à des mares d’eaux dormantes. Loin de fixer les limites du fleuve, ces rives sablonneuses les rendaient incertaines. Elles les rapprochaient ou les éloignaient tour à tour, selon le jeu variable des rayons infléchis.
»A ces traits épars du paysage, à ce caractère de solitude et de grandeur, on reconnaît le cours de l’Orénoque, un des fleuves les plus majestueux du Nouveau Monde. Partout les eaux, comme les terres, offrent un aspect caractéristique et individuel. Le lit de l’Orénoque ne ressemble point aux lits du Meta, du Guaviare, du Rio Negro et de l’Amazone. Ces différences ne dépendent pas uniquement de la largeur ou de la vitesse du courant: elles tiennent à un ensemble de rapports qu’il est plus facile de saisir, lorsqu’on est sur les lieux, que de définir avec précision.»
De ce texte-ci, en plus des caractéristiques déjà relevées dans d’autres, je retiens cette dernière remarque concernant un «ensemble de rapports qu’il est plus facile de saisir, lorsqu’on est sur les lieux, que de définir avec précision». Qu’est-il, cet ensemble de rapports? Comment le dire? Nous voyons déjà se profiler la question de la géopoétique. Mais, pour le moment, accumulons d’autres éléments du voyage physique. Je voudrais évoquer, au raudal d’Atures, ces vautours et ces engoulevents à la voix croassante qui volent solitaires dans les sillons profonds de la vallée, et dont l’ombre glisse sur les flancs nus du roc et disparaît rapidement. Ou bien ce plateau gelé des Andes, entouré de volcans et de soufrières qui dégagent continuellement des tourbillons de vapeur. Ou bien encore, la «route de l’Inca», cet ouvrage gigantesque, large de sept mètres, fait de blocs de porphyre trappéen d’un brun noir, qui couvre les quatre cents lieues entre Quito et Cuzco à une altitude de 3391 mètres. Et, pour finir, Vera Cruz: «C’est ainsi qu’en peu d’heures, dans ce pays merveilleux le physicien parcourt toute l’échelle de la végétation, depuis l’héliconia et le bananier dont les feuilles lustrées se développent dans des dimensions extraordinaires, jusqu’au parenchyme rétréci des arbres résineux.»
Revenu en Europe, Humboldt va faire de Paris, entre 1804 et 1827, sa résidence principale. Tout en continuant à se déplacer (à Rome, à Naples, à Vienne...), tout en remplissant, à distance, jusqu’en 1827, année où le roi le rappelle à Berlin, les fonctions de chambellan de Prusse (il est nommé à ce poste en 1805), tout en participant aux travaux de l’Institut de France et à la Société de géographie de Paris, tout en entretenant une correspondance volumineuse avec des savants du monde entier, il se consacre à la publication des résultats de son voyage américain. Les trente volumes se répartissent comme suit:
|
Vol. 1 et 2 |
Plantes équinoxiales. |
|
Vol. 3 et 4 |
Monographie des mélastomacées. |
|
Vol. 5 |
Monographie des mimoses et autres plantes légumineuses. |
|
Vol. 6 et 7 |
Révision des graminées. |
|
Vol. 8 à 14 |
Nova genera et species plantarum. |
|
Vol. 15 et 16 |
Atlas pittoresque du voyage. |
|
Vol. 17 |
Atlas géographique et physique. |
|
Vol. 18 |
Examen critique de l’histoire et de la géographie du Nouveau Continent. |
|
Vol. 19 |
Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle-Espagne. |
|
Vol. 20 |
Géographie des plantes équinoxiales. |
|
Vol. 21 et 22 |
Recueil d’observations astronomiques, d’opérations trigonométriques et de mesures barométriques. |
|
Vol. 23 et 24 |
Recueil d’observations de zoologie et d’anatomie comparée faites dans l’océan Atlantique, dans l’intérieur du Nouveau Continent et dans la Mer du Sud. |
|
Vol. 25 et 26 |
Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne. |
|
Vol. 27 |
Essai sur la géographie des plantes. |
|
Vol. 28 à 30 |
Relation historique du voyage. |
Si l’on ajoute à ces quelque quinze mille pages, écrites en français et en latin, issues de son voyage américain, les Tableaux de la nature (Ansichten der Natur), écrits en allemand (1808), et le Cosmos (Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung - esquisse d’une description physique du monde), publié en cinq volumes entre 1845 et 1862, sans parler d’autres textes tels que son Voyage en Asie Centrale (1843), qui ne font que confirmer certains de ses points de vue sur «la construction du monde», nous avons un énorme corpus sur lequel réfléchir.
François Arago, astronome et physicien, un des principaux amis et interlocuteurs de Humboldt à Paris, lui disait à propos de ses écrits: «Tu ne sais pas construire; tes livres sont comme des tableaux sans cadre.» C’est rigoureusement vrai. Mais nous n’en tiendrons pas rigueur à Humboldt, nous ne considérerons pas cette caractéristique comme un défaut. C’est en cela que consiste l’intérêt de l’œuvre humboldtienne: elle ne se laisse pas facilement encadrer. Cela est vrai à un niveau purement compositionnel: quand il se met à écrire un essai de quinze pages, il le fait suivre de cent cinquante pages de notes (celui qui déclare que cela est «académique» est complètement à côté de la question). Mais c’est vrai aussi à un niveau conceptuel.
Humboldt est géographe, mais son œuvre déborde du cadre d’une certaine conception française de la géographie. En matière de géographie, la France s’était beaucoup distinguée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Je pense notamment à la fondation, sous le règne de Louis XIV, en 1666, de l’Académie des sciences, qui avait pour mission de préciser la mesure de la terre et de fixer la forme de la terre. Y brilla Picard, qui fonda l’Observatoire de Paris. On peut penser aussi aux cartes de la Chine dressées par les missionnaires jésuites, aux observations faites à Cayenne (1671-1673) par l’astronome Richer, qui constate le premier que la terre n’est pas une sphère, mais un sphéroïde aplati aux deux pôles. On peut égrener d’autres grands noms de la géographie française: La Condamine, Maupertuis, Nicolas Sanson, Guillaume Delisle, d’Anville... Mais dès qu’on arrive à Sébastien de Beaulieu, premier ingénieur du roi, maréchal de camp, le slogan «la géographie sert à faire la guerre» vient à l’esprit - c’est dans ce contexte qu’il trouve son application. La géographie sert à faire la guerre (les opérations militaires ont besoin de cartes) et à faire la chasse (je pense ici à «la carte des chasses du Roi» faite par Berthier entre 1764 et 1773).Certes, au XVIlle siècle, la géographie française maintient sa réputation, avec des monographies cartographiques comme celle des Pyrénées par Roussel, celle des Alpes par Raymond, celle des côtes maritimes de France par Lerouge, et avec toute la série des «Neptune»: le Neptune français de Sauveur, le Neptune oriental de Mannevillette, le Neptune américano-septentrional de Bonne, le Neptune du Cattégat et de la Baltique de Brache, qui date de 1809. Mais le XIXe siècle, géographiquement, n’est plus français. Le dernier monument est sans doute le Précis de la géographie universelle de Maltebrun (1810). A partir de cette date, les grandes études géographiques disparaissent en France, et même les études tout court: il subsiste une seule chaire de géographie, à la Sorbonne, qui se cantonne dans l’étude de la géographie antique (Homère, Hérodote...). Certes, il existe la Société de géographie, mais elle a peu de membres. C’est l’Allemagne qui prend la relève, avec l’énorme masse des travaux de Karl Ritter, à commencer par Erdkunde (Connaissance de la terre) de 1817: «La géographie dans ses rapports avec la nature et l’histoire de l’homme ou géographie universelle comparée, considérée comme base de l’enseignement des sciences physiques et historiques.» Ritter meurt au moment de la sortie de son dix-septième volume (sur l’Asie), laissant des mémoires «destinés à servir de base à une manière plus scientifique d’étudier la géographie».
Avec Ritter, nous passons de la géopolitique à la géognose et à la géographie humaine.
Si féru qu’il soit de culture française, Humboldt appartient plutôt à cette lignée-là. Mais il a ses propres caractéristiques, ses propres élans, qui font qu’il est encore autre chose.
Parlons d’abord de sa méthode. Voici ce qu’il écrit au début de son voyage: «Frappés d’un grand nombre d’objets à la fois, nous éprouvâmes quelque embarras à nous assujettir à une marche régulière d’études et d’observations.» La multiplicité du réel et l’excitation de l’esprit rendent difficile l’adaptation à une discipline routinière. Cela dit, tout au long de son itinéraire, Humboldt accumule les mesures et les calculs (ce n’est que rarement, par exemple la première fois qu’il voit l’océan Pacifique, qu’il oublie son baromètre). Mais il n’en oublie pas le sens de l’ouverture et la sensation du démesuré. Il veut éviter les «rêves systématiques» et les «théories abstraites». Empiriste, il ne se contente pas d’une simple accumulation de faits; théoricien, il se méfie des idées trop vite faites. «Je me suis proposé, écrit-il, [... ] de tenir un juste milieu entre deux routes suivies par les savants... Les uns, se livrant à des hypothèses brillantes mais fondées sur des bases peu solides, ont tiré des résultats généraux d’un petit nombre de faits isolés... D’autres savants ont accumulé des matériaux sans s’élever à aucune idée générale, méthode stérile dans l’histoire des peuples comme dans les différentes branches des sciences physiques.» Méthodologiquement, il se tient sur le «juste milieu» entre deux routes. Mais ce «milieu» demande quelque chose d’encore plus complexe. Ailleurs, il dira que le travail consiste à «recueillir, observer, vérifier et combiner». Ailleurs encore, qu’il s’agit de «saisir les éléments divers d’un vaste paysage». Je dirais volontiers que Humboldt sait pratiquer l’extravagance sans se perdre, et qu’il sait pratiquer la rigueur sans se figer.
Parlons maintenant du terrain. Le terrain de Humboldt, c’est l’Amérique, dont il dit: «Si l’Amérique n’occupe pas une place distinguée dans l’histoire du genre humain et des anciennes révolutions qui l’ont agité, elle offre un champ d’autant plus vaste aux travaux du physicien. Nulle part ailleurs la Nature ne l’appelle plus vivement à s’élever à des idées générales sur la cause des phénomènes et sur leur enchaînement mutuel.» Dans ce champ américain, du moins à ce moment-là, la politique, préoccupée de priorités et d’utilité immédiate, était moins présente, et les disciplines étaient moins étanches les unes aux autres: une liberté de mouvement s’alliait à la nécessité d’être multidisciplinaire. Humboldt est américaniste, au grand sens, si je puis dire, du mot. Il ressemble à ce Samuel Hearne, d’abord aspirant dans la marine royale britannique, ensuite agent de la Compagnie de la Baie d’Hudson, qui allait suivre la rivière de la Mine-de-Cuivre jusqu’à la mer Glaciale (La Pérouse, s’étant emparé des établissements britanniques pendant la guerre d’Amérique, avait trouvé son manuscrit - et le lui rendit, à la condition qu’il le publie, ce qui fut fait en 1795). On peut évoquer aussi dans ce contexte le personnage d’Alexander Mackenzie, agent de la North-West Fur Company, qui va d’abord vers la mer Glaciale, ensuite vers le Pacifique. On peut penser à Lewis et Clark qui remontent le Missouri et traversent les Rocheuses. A Zebulon Pike, qui explore les sources du Mississippi, le bassin de l’Arkansas, le Nouveau Mexique et le Texas. Au Major Long, à Nicollet, à Duflot de Mofras, à Fremont... Humboldt fut au courant de tous ces travaux dans le Nord. Et il était au courant aussi de ce qui s’était passé dans le Sud, depuis les descriptions de la Patagonie du père Falkner jusqu’aux voyages de Lima au Paraguay de Weddell, en passant par les expéditions de Don Felix de Azara au Rio de la Plata, celle du Dr Martins au Brésil, celle de Walter Bates en Amazonie, celle de Fitzroy au détroit de Magellan, celle de Basil Hall au Chili, celle de Pentland en Bolivie, celle d’Alcide d’Orbigny dans les Andes, celle de Schomburgk dans le bassin de l’Orénoque... Il a tout l’espace américain, toutes les recherches américanistes en tête. Et il suit lui-même ses pistes américaines non seulement dans un esprit d’investigation, non seulement avec curiosité, mais avec plaisir: «Le plaisir que l’on éprouve, écrit-il, n’est pas dû seulement à l’intérêt que prend le naturaliste aux objets de son étude, il tient à un sentiment commun à tous les hommes qui sont élevés dans les habitudes de la civilisation. On se voit en contact avec un monde nouveau, avec une nature sauvage et indomptée. Tantôt c’est le jaguar, belle panthère de l’Amérique, qui paraît sur le rivage; tantôt c’est le hocco à plumes noires et à tête huppée, qui se promène lentement le long des sauso. Les animaux de classes les plus différentes se succèdent les uns aux autres. Es como en el Paraiso, disait notre pilote, vieil Indien des missions.» Humboldt partage cette sensation paradisiaque, tout en ne versant pas dans une mythologie facile, que ce soit celle de l’Age d’Or ou celle du Bon Sauvage. Les choses sont compliquées, et non sans contradictions. Au cours de ses pérégrinations dans les terres sauvages, il arrive à Humboldt d’imaginer des entrepôts, des centres de civilisation. Mais dès la fin de son voyage, donc dès le tout début du XIXe siècle, il constate la disparition de palmiers et de bambous autour de La Havane et remarque avec amertume que «la civilisation avance». Là aussi, il y aurait une méthode, une route du «milieu» à trouver.
Mais si Humboldt est américaniste, s’il nage dans tout ce courant américain, il est un moment de l’histoire américaine et américaniste qu’il affectionne tout particulièrement, c’est le moment de la première découverte et de ses suites, immédiates, ce que j’aimerais appeler le moment colombien.
«A aucune autre époque depuis la fondation des sociétés, écrit-il, le cercle des idées, en ce qui touche le monde extérieur et les rapports de l’espace, n’avait été si soudainement élargi et d’une manière si merveilleuse.» Ce «cercle d’idées» comprenait, entre autres, la composition de l’atmosphère et ses rapports avec l’organisation humaine, la distribution des climats au penchant des cordillères, les lois du magnétisme, la liaison des volcans entre eux, le soulèvement successif des chaînes de montagne, la direction des courants pélagiques... Mais, et il insiste là-dessus, il n’y avait pas que «de la science», il y avait comme un sens nouveau, il y avait un charme. Le «nouveau travail des esprits» allait s’élargissant, de cercle concentrique en cercle concentrique. Il revient sur cet élargissement du cercle, du savoir à une espèce d’horizon du savoir, une sorte d’aura du savoir, dans le passage suivant: «Aux époques héroïques de, leur histoire, les Portugais et les Castillans ne furent pas seulement guidés par la soif de l’or, comme on l’a supposé, faute de comprendre l’esprit de ces temps. Tout le monde se sentait entraîné vers les hasards des expéditions lointaines. Les noms d’Haïti, de Cubagua, de Darien avaient séduit les imaginations au commencement du XVIe siècle, comme, depuis les voyages d’Anton et de Cook, les noms de Tinian et d’Otahiti... Plus tard, quand les mœurs s’adoucirent et que toutes les parties du monde s’ouvrirent à la fois, cette curiosité inquiète fut entretenue par d’autres causes et prit une direction nouvelle. Les esprits s’enflammèrent d’un amour passionné pour la nature... Les vues s’élevèrent en même temps que s’agrandissait le cercle de l’observation scientifique. La tendance sentimentale et poétique, qui se trouvait déjà au fond des cœurs, prit une forme plus arrêtée avec la fin du XVIe siècle, et donna naissance à des œuvres littéraires inconnues des temps antérieurs.» Mais tout ce que je viens d’évoquer se concentre aux yeux de Humboldt dans la figure même de Christophe Colomb. Même dépourvu de savoir scientifique précis, mais par son simple sens de l’observation, Colomb avait lui-même contribué aux avancées scientifiques, notamment en ce qui concerne le magnétisme terrestre, la flexion des bandes isothermes et la botanique, par exemple dans cette lettre écrite d’Haïti en octobre 1498, citée par Humboldt: «Chaque fois que, quittant les côtes d’Espagne, je me dirige vers l’Inde, je sens, dès que j’ai fait cent milles marins à l’ouest des Açores, un changement extraordinaire dans le mouvement des corps célestes, dans la température de l’air et dans l’état de la mer. En observant ces changements avec une attention scrupuleuse, j’ai reconnu que l’aiguille aimantée, dont la déclinaison avait lieu jusque-là dans la direction du nord-est, passait au nord-ouest; et après avoir franchi cette ligne, comme on gravit le dos d’une colline, j’ai trouvé la mer couverte d’une telle quantité d’herbes marines, semblables à de petites branches de pins et portant pour fruits des pistaches, que les vaisseaux semblaient devoir manquer d’eau et échouer sur un bas-fond. Avant la limite dont je viens de parler, nous n’avions trouvé aucune trace de ces herbes marines. Je remarquai aussi en arrivant à cette ligne de démarcation, placée, je le répète, à cent milles vers l’ouest des Açores, que la mer s’apaise subitement, et que presque aucun vent ne l’agite plus. Lorsque nous descendîmes des îles Canaries jusqu’au parallèle de Sierra Leone, il nous fallut souffrir une chaleur horrible; mais dès que nous eûmes franchi la limite que j’ai indiquée, le climat changea, l’air s’adoucit et la fraîcheur augmenta à mesure que nous avancions vers l’ouest.» Mais ce n’est pas encore cela qui intéresse le plus Humboldt chez Colomb. C’est, dans les lettres et le journal maritime, le «profond sentiment de la nature» qui animait le grand voyageur, ainsi que «la noblesse et la simplicité d’expression» avec lesquelles il décrivit «la vie de la terre, et le ciel, inconnu jusque-là, qui se découvrait à ses regards (viage nuevo al nuevo ciel i mundo que fasta entonces estaba en oculto)».Humboldt revient sur cet aspect plus «sensible», plus «poétique» dans le passage suivant: «Nous apprenons ici, par le journal d’un homme dépourvu de toute culture littéraire, quelle puissance peuvent exercer sur une âme sensible les beautés caractéristiques de la nature. L’émotion ennoblit le langage. Les écrits de l’amiral, surtout lorsque, âgé déjà de soixante-sept ans, il accomplit son quatrième voyage et raconte sa vision merveilleuse sur la côte de Veragua, sont, sinon plus châtiés, du moins plus entraînants que le roman pastoral de Boccace, les deux Arcadies de Sannasar et de Sidney, le Salicio y Nemoroso de Garcilasso ou la Diana de Jorge de Montemayor.» Nous avons là les prémices d’une littérature géopoétique.
Quand Humboldt revient de son voyage américain, c’est une poétique de cette sorte qu’il a en tête, et pour lui, c’est à l’élaboration et à la propagation de cette poétique que devraient s’appliquer les esprits. Il s’agit de l’accomplissement d’une de ces «grandes pensées dont la source est dans les profondeurs de l’âme». Après le voyage physique, donc, avec ses résultats, le voyage mental, avec son réseau.
Toute œuvre d’envergure demande des ressources illimitées et quelque chose comme une éternité. Humboldt avait dépensé la moitié de sa fortune pour son voyage, il allait en dépenser l’autre moitié dans la publication des «actes» de ce voyage. On sent qu’il envie, un peu, le grand botaniste colombien, Don José Celestino Mutis, qui avait été l’ami de Linné, et à qui le roi versait pour ses travaux dix mille piastres par an - d’autant plus qu’au moment où Humboldt le rencontra, Mutis avait depuis quinze ans une trentaine de peintres à sa disposition. Mais Humboldt est beaucoup plus qu’un grand botaniste, et sa recherche profonde était moins visible, moins perceptible, moins concevable - certains auraient pu dire même «non scientifique». Certes, il a fait de grandes contributions à la botanique: de son voyage il avait rapporté cinquante-huit mille espèces de plantes, dont trois mille six cents inconnues. Avec ses mesures astronomiques et trigonométriques, il avait fait une grande contribution à la géodésie, comme à bien d’autres branches de la science. Avec sa géographie des plantes (à plusieurs points de son voyage, il dresse le tableau des étages de végétation), il est à l’origine de ce qu’on appelle la géographie tridimensionnelle. Et il n’allait jamais cesser de s’intéresser à tous les aspects de la recherche scientifique, «soit qu’il s’agisse (je le cite) de l’électromagnétisme, de la polarisation de la lumière, des effets produits par les substances diathermanes, ou des phénomènes physiologiques que présentent les organismes vivants - vaste ensemble de merveilles qui se déroulent à nos regards comme un monde nouveau dont nous touchons à peine le seuil !» Mais c’est encore autre chose qui l’attire, qui l’inspire. En jouant un peu sur les mots, on pourrait dire qu’il s’intéresse à une géographie quadridimensionnelle. Disons qu’il veut ajouter une dimension de plus à la géographie, à la science, à la connaissance. Et cette dimension est plus qu’une dimension «humaniste», comme dans la géographie dite humaine. Au cours de son voyage, Humboldt s’était rendu compte d’une dimension de l’existence où une conscience humaine est certes présente, mais où l’image de l’homme dont nous avons philosophiquement et psychologiquement l’habitude n’a plus de raison d’être: «Dans cet intérieur des terres du nouveau continent, on s’accoutume presque à regarder l’homme comme n’étant point essentiel à l’ordre de la nature.» Un dépouillement de l’homme, un être moins imposé et imposant, serait à l’ordre du jour... Il n’est certes pas aisé de trouver un concept global adéquat. D’une manière générale, notre vocabulaire conceptuel laisse beaucoup à désirer. Si l’ethnographie se veut uniquement collectrice et descriptive, l’ethnologie se permet, à partir de matériaux ethnographiques, d’élaborer des théories. Par analogie, si la géographie est la description de la terre, la géologie devrait signifier «théorie de la terre», mais il n’en est rien - nous avons affaire seulement à un aspect spécial et spécialiste de la géographie. Humboldt, comme on l’a constaté, utilise assez souvent le terme de «géognose», mais là aussi, le sens est très spécifique -il s’agit de la configuration de la terre, non pas de la configuration d’un nouvel esprit général des choses. Au cours de son voyage, Humboldt avait été abordé par des gens munis de vagues et confuses notions d’astronomie et de physique qui voulaient parler de «nouvelle philosophie» - il trouvait ça absurde, comme il aurait trouvé absurdes tant d’autres «nouveautés». Pour des raisons que j’ai déjà évoquées, et pour d’autres qui vont émerger de ce qui va suivre, je pense que le terme le plus adéquat est «géopoétique». L’œuvre de Humboldt constitue une approche, et une des plus intéressantes, de ce que l’on peut appeler «géopoétique» aujourd’hui.
Dans deux textes, il en fait même très précisément la généalogie. Le premier s’intitule Histoire de la contemplation physique de l’univers, le deuxième Descriptions poétiques de la nature.
Au premier abord, l’Histoire de la contemplation physique de l’univers pourrait ne sembler qu’une histoire abrégée de la science, des sciences. Mais les sciences séparées ne peuvent fournir que des matériaux pour le fondement de ce que Humboldt appelle «la science du cosmos», ou encore «le développement de l’idée de cosmos», ou bien encore, en citant Otfried Müller, l’élaboration de l’«idée poétique de la terre».
Pour le propos général, il cite son frère, Wilhelm von Humboldt: «Il peut paraître étrange de vouloir allier la poésie, qui se plait dans la variété, la forme et la couleur, aux idées les plus simples et les plus abstruses. Mais cela se justifie pleinement. La poésie, la science, la philosophie et l’histoire ne sont pas essentiellement séparées les unes des autres. Elles sont unies, ou bien quand une certaine étape du progrès humain situe l’homme dans un état unitaire, ou bien quand une inspiration authentiquement poétique projette l’individu dans un tel état.» Humboldt se lance alors dans son historique, en prenant le soin de préciser qu’il va aller vite, qu’il ne s’agit pas de se perdre dans les détails, mais de voir des lignes de crête, de dessiner une configuration (certaines époques, certaines œuvres peuvent n’avoir qu’une ligne intéressante, c’est celle-là qu’il s’agit de dégager, en la combinant avec d’autres dégagées d’autres contextes).
Dans l’Histoire de la contemplation physique de l’univers, Humboldt distingue, en Occident, sept époques, sept aires: 1º la Méditerranée; 2º la Macédoine sous Alexandre le Grand; 3º l’Egypte des Ptolémée; 4º l’Empire romain; 5º l’Arabie; 6º les grandes découvertes océaniques; 7º les découvertes célestes. Grâce à l’esprit «vivant et mobile» des Grecs, la Méditerranée avait connu «un élargissement rapide du cercle des idées». Mais il n’y avait pas que les Grecs, il y avait les Phéniciens, avec leurs voyages et leur alphabet, les Etrusques, avec leur «penchant à cultiver des rapports intimes avec les phénomènes naturels». S’alliaient donc une expansion vers le monde extérieur et une augmentation de la vision contemplative... Avec Alexandre, «le nouveau champ à considérer» prenait d’autres proportions encore: de nouveaux matériaux exigeaient de nouvelles coordinations, une nouvelle compréhension intellectuelle - recherche empirique rencontrant haute spéculation, le tout essayant de trouver son langage. Si, en Egypte, l’école d’Alexandrie tenait à s’enfermer dans la pure érudition, manquant d’«esprit animé», il y eut pourtant Eratosthène, qui avait un «œil intellectuel». A Rome aussi, pour ce qui est de la «formation de conceptions supérieures», il y a un manque, mais Strabon, celui qui, après avoir écrit quarante-trois livres d’histoire, se mit à son ouvrage géographique à l’âge de quatre-vingt-trois ans, avait une bonne connaissance de l’Empire, depuis l’Arménie jusqu’à la côte tyrrhénienne, depuis la mer Noire jusqu’aux bords de l’Afrique, et Pline (Plinius Secundus) sentait qu’il marchait sur des sentiers jamais foulés avant lui («non trita autoribus via»). Dommage qu’il se soit perdu dans des détails de spécialiste, au lieu de garder dans l’esprit une «image unique» potentielle. Chez les Arabes, l’intérêt de Humboldt se porte sur les tribus nomades, qui connaissent «le visage ouvert de la nature» et qui ont «une sensation plus fraîche des choses» qu’il ne fut possible dans les cités grecques et romaines. Chez les voyageurs et géographes arabes, il constate une sensation et une connaissance de l’espace plus grandes encore que, chez Marco Polo ou les moines bouddhistes. Il évoque El-Istachri et son Livre des régions du monde, Ibn Sinâ (Avicenne), le botaniste Ibn Baithar et Ibn Ruschd (Averroes), qui surent suivre «les chemins solitaires du développement des idées». Il se penche ensuite sur les grandes cosmographies qui, en agrandissant la vision des choses, ont ouvert la voie aux découvertes océaniques: le Liber cosmophicus de natura locorum d’Albertus Magnus, le Fenix de las maravillas del Orbe de Raymond Lulle, l’Imago Mundi de Pierre d’Ailly, beaucoup lu par Colomb, sans oublier l’Opus Maius de Roger Bacon. Défilent alors devant nos yeux Plan Carpin, Sir John Mandeville, Balduccio Pegolotti, Ruy Gonzalez de Clavijo, et Colomb lui-même, toujours lui, muni du livre de Pierre d’Ailly ainsi que de la carta de marear que lui avait envoyée Toscanelli de Florence, suivi de Magellan, de Balboa, de Cortez, de Léonard de Vinci, dont les idées les plus intéressantes sont restées longtemps dans ses manuscrits (e.g. le Codex Atlanticus), et Dante, qui avait vu des cartes célestes arabes et parlé avec des voyageurs en Orient, et qui savait allier érudition, errance intellectuelle et inspiration... Et on en arrive à la septième époque, celle de l’ouverture de l’espace astronomique grâce au télescope, où nous rencontrons les figures de Léonard Euler, de Copernic (De revolutionibus orbium caelestium), de Kepler, de Huygens, de Herschel et de Galilée.
Humboldt insiste sur le fait que cette étude, écrite d’une manière «fragmentaire et générale» ne vise ni à être parfaite ni à être complète. C’est très précisément une esquisse. Mais il aurait été prêt à reconnaître que même en tant qu’esquisse, elle peut laisser à désirer, d’un point de vue qui ne soit ni celui de la perfection, ni celui de l’exhaustivité. Par exemple, il n’arrive pas à se maintenir sur, la ligne de crête qu’il s’était proposée - il va parler de la polarisation de la lumière étudiée par Arago, alors que cela appartient à la «science spéciale», et non pas à la «science du cosmos». Et il a des problèmes de composition. En fait, comme on le verra, une des questions que se pose, de plus en plus, Humboldt, est celle d’une poétique - non pas une poétique de la perfection, mais une poétique de la pérégrination: informée, intelligente, animée, réjouissante, éclairante et inspirante. L’essentiel, c’est que, dans son étude fragmentaire sur la «contemplation physique de l’univers», se trouvent quelques-unes de ces pistes qu’il a voulu dessiner, ces pistes de la pensée qui, un jour, mèneront à une «image», c’est-à-dire à une grande vision poétique du monde. L’accent est sur l’ouverture, sur l’avancée. «Les esprits faibles, écrit-il, sont toujours prêts, à toutes les époques, à déclarer avec complaisance que l’humanité a atteint le sommet du progrès intellectuel» - ou, ajouterons-nous, en pensant à l’époque actuelle, à déclarer que tout est terminé. Mais en fait, le champ à explorer devient de plus en plus vaste, l’horizon recule toujours: «il existe des forces, opérant encore silencieusement dans la nature élémentaire, comme dans les délicates cellules des tissus organiques, dont nous ne sommes pas encore conscients mais qui, un jour, entreront dans le champ de la connaissance». Il faudra encore beaucoup de temps, beaucoup d’observations, beaucoup de combinaisons, et beaucoup de communication. Bref, pour ceux qui sont conscients, le champ s’élargit et s’approfondit tous les jours. Voilà le dernier mot de Humboldt sur la «contemplation physique».
Reste la question de l’expression, qui n’est pas une question secondaire, mais une question primordiale, car l’être de l’homme a besoin de s’exprimer - mais quel homme, quel être, quelle expression? C’est à la «généalogie de l’expression poétique» satisfaisante, éclairante, que s’attache Humboldt dans l’autre étude fondatrice, Descriptions poétiques de la nature. Et de même que dans l’étude sur la «contemplation physique», il n’écrivait pas l’histoire des sciences, de même ici Humboldt n’écrit pas l’histoire de la littérature, mais élabore, grâce à quelques incursions perspicaces et perspectivistes dans le corpus de la littérature mondiale, la géographie de la puissance poétique, c’est-à-dire du rapport le plus profond entre l’homme et... la nature (aucun mot, ici, n’est satisfaisant). Les mots d’Humboldt, comme on a déjà pu le constater, sont ceux de son époque. Humboldt est un scientifique, un intellectuel, qui a une «vision», une «prémonition» de la poésie dont sont incapables la plupart de ceux qui sont appelés ou qui s’appellent «poètes». On est dans le paradoxe, le paradoxe excitant - c’est ce qui remplace avantageusement le paradis. Humboldt va donc utiliser les mots «sentimental» (qui lui vient de Schiller, dont le texte l’Education esthétique de l’humanité n’est pas étranger à tout ce contexte), «romantique», «pittoresque» - mais sa lancée dépasse son langage. Son exploration de la littérature poétique depuis les Grecs et les Romains jusqu’aux «voyageurs modernes» veut ouvrir un espace de possibilités inouïes - encore une fois, il s’agit de repérer, de comparer, de combiner, de composer: géographie multi-dimensionnelle du verbe...
Pour Humboldt, dans la littérature grecque classique, l’accent est mis exclusivement sur l’humain: passion et politique, la nature ne servant que de toile de fond, ou comme répertoire de comparaisons. Même quand on traite plus spécifiquement de la nature, l’approche est descriptive, didactique, il y a peu de «contemplation inspirée». Mais il existe quelques exceptions à cette règle, parmi elles les Dionysiaca de Nonnos de Panopolis. Quant aux Romains, leur esprit est légiste, militaire ou domestique, et leur langue a moins de «mobilité idéale» que le grec, mais Lucrèce se distingue par son «génie fertile», et on trouve une présence de la nature chez Virgile, Horace, Tibulle, Ovide, sans oublier «la belle description d’une forêt druidique» chez Lucain, ce qui fait noter à Humboldt, en passant, que chez les anciennes tribus germaniques et celtiques on constate une véritable «vénération de la nature», exprimée par «de rudes symboles». Chez les poètes hébreux, la nature est l’expression vivante de l’omniprésence de Dieu, et leur intérêt se porte moins sur des phénomènes isolés que sur des «grandes masses». Comment nier la grandeur du Psaume 104: «Les arbres du Seigneur sont pleins de sève, les cèdres du Liban qu’il a plantés...», ou bien encore le livre de Job: «Le Seigneur marche sur les hauteurs de la mer, sur la crête des vagues amoncelées par la tempête» - tout en se disant, peut-être, que dans ce spectacle divin, Dieu occupe un peu trop la scène. Pour Humboldt, le christianisme avait libéré l’œil contemplatif en le détournant des dieux, de sorte que la nature prend toute sa valeur - création et expression de Dieu, certes, comme dans la poésie hébraïque, mais d’une manière moins théocratiquement imposante. Il cite comme un de ses textes préférés une lettre de Basile, un Grec de Cappadoce, ermite chrétien sur les rives de l’Iris en Arménie: «Te parlerai-je du beau chant des oiseaux, et de la profusion de fleurs ? Ce qui me charme le plus, c’est la tranquillité absolue de la région...» Il y a dans cette lettre, dit Humboldt, des sentiments et des sensations plus proches de ceux de l’époque moderne que tout ce que l’on peut trouver chez les Grecs ou chez les Romains. Mais le christianisme allait se détourner de plus en plus de la nature, y voyant le diable, et de toute étude de la nature, y voyant de la sorcellerie... En Asie, l’aube et le soleil resplendissent dans le Rig-Veda, symboles d’une religion cosmique dont on retrouve des éléments dans la mythologie populaire, par exemple la vie de Râma dans la forêt, ou bien encore dans la poésie de Kâlidâsa qui, dans le Meghaduta, décrit le passage d’un nuage ainsi que les paysages qu’il traverse. Chez les Perses (Firdûsî, Hâfiz, Saadi, AI Rûmî) la grande nature est moins présente, leur intérêt se portant sur des paysages aménagés (jardins, fontaines...) et sur des artifices de forme.
Les Arabes, eux, aiment chanter la guerre et l’amour, mais il y a aussi la vie du désert, telle qu’on la trouve dans la romance bédouine Antar. Après ce tour du monde antique, Humboldt, toujours à la recherche d’éléments d’une «poésie de la nature» satisfaisante, se tourne vers le monde moderne, à commencer par Dante Alighieri, «le fondateur inspiré du nouveau monde», dont la puissance référentielle et intellectuelle n’a d’égale que sa sensibilité à des impressions immédiates, telle «il tremolar della marina». Signe des temps aussi, l’ascension du mont Ventoux par Pétrarque, qui, malheureusement, reste empêtré dans l’allégorie et dans la morale. Bembo, par contre, dans son Aetnae Dialogus, donne un tableau animé de la géographie des plantes sur le volcan, depuis les champs de blé de la Sicile jusqu’aux marges enneigées du cratère. Et puis, encore et toujours, Colomb, décrivant la terre nouvelle avec ses arbres et ses fruits et ses lindas aguas, sentant que «mille langues ne suffiraient pas à la dire: "Para hacer relacion a los Reyes de las cosas que vian, no bastaran mil lenguas a referillo, ni la mano para la escribir, que le parecia questaba encantado. "» Et Camoens à Macao, emporté par la mer, le vent et les nuages, marin de l’âme, chantre de la gloire portugaise, qui pourtant parle beaucoup plus des épices, à valeur commerciale, que d’autres plantes tropicales... On passe alors par Shakespeare, sensible à «l’expression individuelle de la nature», et par Milton, sublime, mais dont les descriptions sont plus magnifiques que graphiques, pour arriver au XVIIIe siècle, à l’époque des Buffon, Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, à toute une nouvelle série de tentatives pour s’approcher de la nature et pour dire ce terrain de rencontre d’une manière à la fois exacte et inspirante. Buffon accumule les faits exacts, mais ses phrases sont construites trop artificiellement et on ne sent pas chez lui cette «analogie mystérieuse entre les mouvements de l’esprit et les phénomènes perçus par les sens» qui est l’objet des recherches de Humboldt à ce stade ultime de ses pérégrinations. Chez Rousseau, le moi est souvent trop présent; chez Chateaubriand, pourrait-on dire, aussi, lui dont les passages à travers la terre s’accompagnent toujours de souvenirs historiques. Quant à Bernardin de Saint-Pierre, Humboldt l’a beaucoup lu, et avec délices, mais ses théories sont trop souvent saugrenues. Au fond, dès qu’il est question de nature à l’époque moderne, il est difficile de sortir du pastoral, de l’élégiaque, de l’idyllique, du didactique, de l’excessivement sentimental, etc. On a beau écrire d’une manière élevée, la pauvreté des matériaux et de l’information de base est par trop évidente -d’où, d’ailleurs, des tentatives de compensation par le style. Dans le passé, dans les anciens livres de voyages, par exemple, la pauvreté des matériaux était compensée par la naïveté, par une faculté d’émerveillement enfantine, ou encore par la dramatisation, une coloration épique. Mais rien de tout cela n’est possible aujourd’hui, c’est autre chose qu’il faut trouver. Nous avons affaire à une masse d’informations qu’il s’agit non seulement d’ordonner, mais à laquelle il faut aussi donner une aura, une lumière. Il serait possible d’atteindre à «une espèce de délice intellectuel» que les Anciens ne pouvaient connaître - mais quelle littérature est vraiment à la hauteur? On peut recueillir des éléments par-ci, par-là, mais on attend toujours «un élargissement du champ de l’art», on attend toujours une poétique qui sache «présenter à la contemplation de l’intellect et de l’imagination la riche matière du savoir moderne». Il ne peut être question de vagues analogies, de métaphores creuses, de mythes symbolistes, il s’agit de définition et de respiration, d’exactitude et d’extase, de sensorialité et d’intelligence, et d’une écriture qui soit autre chose que «du style», ou je ne sais quelle «prose poétique» maniérée.
Tout au long de son œuvre, depuis les premières notes prises dans les llanos, ou dans la forêt tropicale humide, ou sur les rives de l’Orénoque, jusqu’aux rédactions et aux compositions de Paris et de Berlin, Humboldt a essayé lui-même de s’approcher de cette littérature plus que «de la littérature» qu’il voyait poindre à l’horizon. On peut dire que cette œuvre consiste en relations, en études et en essais poétiques. Ces «essais poétiques» peuvent se trouver dans les relations et dans les études dont j’ai déjà cité quelques exemples, mais Humboldt y a consacré un livre spécifique, les Ansichten der Natur, traduit en français par Vues de la nature et en anglais par Views of Nature. Il n’y a rien à reprocher à ces deux traductions. Cela vaut cependant la peine de faire remarquer que dans une lettre adressée à son éditeur londonien, Humboldt lui-même écrit «views into nature». On peut imputer cela à l’insuffisance de son anglais, on peut aussi y voir une nuance intéressante.
Il s’agit dans les Ansichten de tentatives de «tableaux intégrés», où se lirait «la coopération des forces» de la nature, dans une prose qui se veut à la fois vigoureuse et flexible, le tout voulant à la fois engager l’imagination, augmenter la connaissance des choses (configurations cachées, relations plastiques profondes), et enrichir la vie par la présentation de nouvelles idées. Avec une petite fable, «La force vitale, ou le génie rhodien», qui n’y a sans doute pas véritablement sa place (mais Humboldt a du mal à «caser» tout ce qui lui vient à l’esprit), il y a dans ce livre six essais en tout: «Les steppes et les déserts», «La vie nocturne des animaux dans la forêt primitive», «Idées pour une physionomie des plantes», «Sur la structure et le mode d’action des volcans», «Le plateau de Caxamarca». Dire que ces essais répondaient complètement à ses vœux serait exagéré, disons simplement que c’est le livre auquel, en fin de compte, il tenait le plus, c’est là qu’il a mis le plus de lui-même, c’est là qu’il a consigné le plus de ses aperçus, c’est là qu’il offre le plus d’indications.
Le voici de nouveau sur les llanos, ces «steppes» du Venezuela:
«C’est dans la Mesa de Paja, par les 9° de latitude, que nous entrâmes dans le bassin des llanos. Le soleil était presque au zénith; la terre partout où elle se montrait stérile et dépouillée de végétation, avait jusqu’à 48° et 50° de température. Aucun souffle de vent ne se faisait sentir à la hauteur à laquelle nous nous trouvions sur nos mulets; cependant, au milieu de ce calme apparent, des tourbillons de poussière s’élevaient sans cesse chassés par ces petits courants d’air qui ne rasent que la surface du sol et qui naissent des différences de température qu’acquièrent le sable nu et les endroits couverts d’herbe. Ces vents de sable augmentent la chaleur suffocante de l’air. Chaque grain de quartz, plus chaud que l’air qui l’entoure, rayonne dans tous les sens, et il est difficile d’observer la température de l’atmosphère sans que des molécules de sable ne viennent frapper contre la boule du thermomètre. Tout autour de nous, les plaines semblaient monter vers le ciel, et cette, vaste et profonde solitude se présentait à nos yeux comme une mer couverte de varech ou d’algues pélagiques. Selon la masse inégale des vapeurs répandues dans l’atmosphère, et selon le décroissement variable de la température des couches d’air superposées, l’horizon, dans quelques parties, était clair et nettement séparé; dans d’autres, il était ondoyant, sinueux et comme strié. La terre s’y confondait avec le ciel. A travers la brume sèche et des bancs de vapeurs on voyait au loin des troncs de palmiers. Dépourvus de leur feuillage et de leurs sommets verdoyants, ces troncs paraissaient comme des mâts de navires qu’on découvre à l’horizon.
Il y a quelque chose d’imposant, mais de triste et de lugubre dans le spectacle uniforme de ces steppes. Tout y paraît immobile: à peine quelquefois l’ombre d’un petit nuage qui parcourt le zénith et annonce l’approche de la saison des pluies, se projette sur la savane. Je ne sais si l’on n’est pas autant surpris au premier aspect des llanos qu’à celui de la chaîne des Andes. Les pays montagneux, quelle que soit l’élévation absolue des plus hautes cimes, ont une physionomie analogue; mais on s’accoutume avec peine à la vue des llanos de Venezuela et de Casanare, à celle des pampas de Buenos Ayres et du chaco, qui rappellent sans cesse, et pendant des voyages de vingt à trente jours, la surface unie de l’Océan. J’avais vu les plaines ou llanos de la Mancha en Espagne, et les bruyères (ericeta) qui s’étendent depuis l’extrémité du Jutland, par le Lunebourg et la Westphalie, jusqu’en Belgique. Ces dernières sont de véritables steppes dont l’homme, depuis des siècles n’a pu soumettre que de petites portions à la culture; mais les plaines de l’ouest et du nord de l’Europe n’offrent qu’une faible image des immenses llanos de l’Amérique méridionale.»
Mais si typique qu’il soit, si graphique et proto-géopoétique (si je puis dire), ce n’est pourtant pas avec ce texte que je voudrais terminer le présent essai. C’est avec un texte du voyage consacré au Chimborazo, que je vais transcrire, parce qu’il s’y prête, en forme de vers :
C’est ainsi qu’au bord de la mer du Sud
après les longues pluies de l’hiver
lorsque la transparence de l’air
a augmenté subitement
on voit paraître le Chimborazo
comme un nuage à l’horizon
il se détache des cimes voisines
il s’élève sur toute la chaîne des Andes
comme ce dôme majestueux
ouvrage du génie de Michel-Ange
sur les monuments antiques
qui environnent le Capitole...
Humboldt n’a pas atteint le sommet du Chimborazo (voulez-vous y voir un symbole ?), ayant été pris avant par le mal des montagnes. Mais je ne vois guère, à l’époque moderne, d’esprit qui soit allé plus loin et plus haut, en charriant autant de matière.
Et dans le nuage qu’il évoque dans ces dernières lignes citées, se cache, comme un éclair, le projet géopoétique.
Kenneth WHITE